20/01/2025
Marthe, roman, Les Sœurs Vatard, Joris-Karl Huysmans (par Patryck Froissart)
Marthe, roman, Les Sœurs Vatard, Joris-Karl Huysmans (par Patryck Froissart)
Marthe, roman, Les Sœurs Vatard, Huysmans, Folio Classique, octobre 2024, 544 pages, 9,40 €
Ecrivain(s): Joris-Karl Huysmans Edition: Folio (Gallimard)

Cette réédition est présentée, établie, préfacée et annotée par Francesca Guglielmi. La somme des deux romans est suivie d’une Chronologie détaillée, rédigée par Francesca Guglielmi et André Guyaux, d’une intéressante notice sur la genèse et la réception des deux ouvrages, et d’une importante et précieuse bibliographie.
Marthe
C’est « l’histoire d’une fille », terme ici socialement méprisant désignant au 19ème siècle une femme aux mœurs légères.
Le parcours narratif est relativement banal, fait d’une succession de promotions et de régressions dans l’échelle de la pauvreté sociale, de périodes stables pendant lesquelles toit, table, trousseau, lit, statut socio-économique et amant régulier et protecteur, voire proxénète (on supporte un temps ses coups, ses brimades, ses humiliations et l’obligation de subvenir à ses besoins financiers) semblent devoir s’imposer durablement, et de chutes et rechutes, progressives ou brutales, vers et dans la précarité, les privations, l’inconfort, jusqu’un état de misère d’autant plus durement ressenti qu’il succède à un épisode dont on éprouve, malgré « les illusions perdues », une nostalgie persistante, et dont on va s’efforcer de retrouver les aspects équivoques avec un autre partenaire, quitte à laisser choir dans un ruisseau de plus en plus glauque amour-propre, dignité, et reste de morale.
Mais si l’intrigue accroche, ce qui est le cas, ce n’est pas tant par la chaîne narrative des péripéties auxquelles est confrontée Marthe, dont l’existence chaotique, jusqu’au désir de suicide, attire irrésistiblement quelque empathie, que par le talent de l’auteur à les inscrire dans le contexte d’une réalité sociale, économique, historique qu’il (re)crée avec un extraordinaire souci du détail.
Car par ce premier roman achevé en 1876, censuré en France, par ce récit cruel des vicissitudes d’une prostituée aléatoire, Huysmans assure et assume sa place dans le mouvement naturaliste, réaliste, où se retrouvent Zola (Nana), Maupassant (Boule de suif), Edmond de Goncourt (La fille Élisa) et d’autres romanciers du dernier quart du XIXe siècle, une trentaine d’années après la parution de Splendeurs et misères des Courtisanes.
La singularité du roman de Huysmans tient d’une part à la sombreur des mises en situations, à la tonalité négative, très dépréciative, des représentations du peuple des bas quartiers, d’autre part au remarquable travail sur la langue auquel se livre l’auteur pour donner de façon maximalement pittoresque une expressive réalité à la société qu’il dépeint, telle qu’il la voit. En cela, Huysmans se montre plus « réaliste » que les romanciers cités plus haut, et son naturalisme atteint ce point extrême, paradoxal, d’un hyper-réalisme qui théâtralise les scènes de vie jusqu’à les rendre, à la lecture, pourrait-on dire, hyper fictionnelles. Quel tour de force ! Il ne transcrit pas « le » monde, il façonne, même si ce n’est pas là son dessein littéraire, « un » monde qu’il souhaite a priori rendre exactement conforme à celui qu’il s’applique à observer avec la lorgnette d’un professeur d’histoire naturelle. Et ce petit monde, ô magie, prend vie, trucule, s’agite, souffre, s’affronte, se déchire, se corrompt, vibre et fourmille en mini cour des miracles, se fait plus vrai que nature, tout en ayant pour fondement des descriptions couvrant des pages entières pouvant passer pour des articles d’encyclopédie : celle, scientifique, de la fabrication de perles artificielles (un des métiers de Marthe), celle, sociologique, du fonctionnement régulier des maisons closes (dont Huysmans était, avant ses crises aiguës de dévotion, de même que l’étaient Maupassant, Flaubert et autres, un visiteur assidu), celles, topographiques, anthropologiques, semblables à des compositions photographiques, de quartiers, rues, boutiques, commerces, avec les personnages les animant, et cetera.
Les sœurs Vatard
Après le roman de Marthe, brillant premier coup n’ayant toutefois pas eu immédiatement, en partie à cause de la censure, le succès escompté et assurément mérité, paraît en 1878 celui des Sœurs Vatard, dédicacé à Zola, beaucoup plus long, plus dense, plus riche, sur le même registre. Le talent de dramaturge de Huysmans confine ici au génie. Alors que Marthe était « le » personnage central, l’héroïne pivot autour de quoi tournait le manège des autres protagonistes, ce second roman, comme son titre le laisse entendre, s’articule sur deux sœurs, deux caractères contraires, dont la mise en contraste pourrait rappeler, la crudité des séquences sexuelles en moins, les Justine et Juliette de Sade.
Désirée l’aînée, la délurée et Céline la vergogneuse que l’auteur appelle volontiers « la petite » mènent toutes deux un parcours sentimental heurté.
Désirée, jouisseuse, d’un naturel noceur, a pour amants réguliers, après avoir été exploitée par une série de suborneurs, de godelureaux, de mirliflors, d’abord l’alphonse macho prénommé Auguste puis le peintre pusillanime Cyprien, deux personnages dont les caractères sont puissamment brossés par le romancier. Céline, irrésolue, tiraillée entre sa morale personnelle, l’éveil des sens, son dévouement pour un père exigeant et une mère impotente, l’exemple et les conseils parfois moralement subversifs de sa sœur dévoyée, et un romantisme à l’eau de rose, a pour amoureux transi l’ouvrier Anatole, et comme prétendant le petit-bourgeois Amédée que le père Vatard veut lui faire épouser.
L’usage de la langue populaire, de l’argot (évoquant, ici et là, le pittoresque brut de l’écriture de l’oublié Aristide Bruant dans La Loupiote) et de la représentation minutieuse de la réalité des lieux, des us, des occupations, des comportements, des techniques, atteint ici son summum.
Le double parcours narratif des sœurs comprend d’une part des épisodes au cours de quoi chacune poursuit sans l’autre sa propre intrigue, conflue d’autre part lors de parties communes avec les partenaires respectifs en foires, bistrots, bouchons, beuglants toujours situés cartographiquement dans un Paris reconstitué, et toujours dépeints avec une précision extrême, et a pour nœuds de croisement réguliers tantôt l’atelier de brochage (dont le fonctionnement et les relations entre employés sont bien sûr expliqués rationnellement par un Huysmans propriétaire et directeur dans la vie réelle d’un semblable atelier) où travaillent les sœurs Vatard et Anatole, où Auguste ne manque pas de venir faire son grabuge, tantôt la maison familiale des sœurs Vatard. Cette structure en alternance judicieusement mesurée fonctionne au mieux et fait de ce roman une œuvre qui mériterait d’être mieux (re)connue.
Une des questions prêtant à débat dans le Landerneau littéraire contemporain à propos de ces deux romans ferait passer Huysmans pour misogyne et pour porteur d’un certain mépris bourgeois pour les membres des catégories sociales mises en scènes… S’il est vrai que l’image de la femme est ici la plupart du temps négative, les portraits d’hommes ne sont pas eux-mêmes positifs, s’il est certain que les tableaux des mœurs et coutumes des quartiers choisis sont généralement déprisants, si les propos et les faits et gestes des personnages secondaires peuvent paraître ici et là outrancièrement grossiers, si le style global a été publiquement dit « vulgaire » par Flaubert, il appartient à chaque lecteur, à chaque lectrice, de se faire ou non son propre jugement après avoir, quoi qu’il en soit, goûté une lecture savoureuse.
Patryck Froissart
Joris-Karl Huysmans est un auteur et critique d’art français. Il fit toute sa carrière au ministère de l’Intérieur, où il entra en 1866. En tant que romancier et critique d’art, il prit une part active à la vie littéraire et artistique française dans le dernier quart du XIXe siècle et jusqu’à sa mort.
- Vu : 426
15:48 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
La Lumière vacillante, Nino Haratischwili (par Patryck Froissart)
La Lumière vacillante, Nino Haratischwili (par Patryck Froissart)
https://www.lacauselitteraire.fr/la-lumiere-vacillante-ni...
La Lumière vacillante, Nino Haratischwili, Gallimard, Coll. du monde entier, septembre 2024, trad. allemand, Barbara Fontaine, 720 pages, 27,50 €
Edition: Gallimard

Voici un roman fleuve qui n’est certainement pas un long fleuve tranquille.
Après La Huitième vie, une fresque de 1200 pages présentée dans notre magazine en octobre 2021, Nino Haratischwili récidive avec ce carrousel romanesque de plus de 700 pages, servi comme le précédent ouvrage par la remarquable traduction de Barbara Fontaine.
Le prétexte, ou le sous-texte, ou le texte-cadre, est une exposition posthume, à Bruxelles, en 2019, des photos réalisées tout au long de sa vie par la célèbre photographe géorgienne Dina, l’un des personnages de premier plan de ce roman à l’écriture prolifique. Parmi les visiteurs se retrouvent Keto, la narratrice, Ira et Nene, les trois amies indéfectibles, depuis l’école primaire, de la défunte artiste dont l’absence hante, lancinante, la mémoire des protagonistes.
« Et mon corps la recherche, je me tends vers quelque chose qui ne vient pas, qui ne viendra plus jamais, et je persiste dans cette posture tandis que les gens, autour de moi, se dissolvent dans la musique. Mon corps me signale que son absence est une injustice criante, un scandale dont je ne veux pas m’accommoder ».
Entre deux échanges tantôt avec l’une, tantôt avec l’autre, tantôt avec ses deux amies d’enfance, Keto passe en revue la galerie de photos, s’arrêtant impulsivement devant celles qui réveillent brusquement, parfois même brutalement, des souvenirs, heureux pour certains, le plus souvent violents, de leur vie à Tbilissi, depuis leur enfance jusqu’à la mort tragique de Dina, événement qui a coïncidé avec une relative disjonction du cours jusque-là étroitement confluent de leurs quatre existences, cours toutefois, naturellement, jalonné de disputes, de désaccords, de réconciliations, et ponctuellement de réaffirmations d’une sororité se révélant finalement plus forte que toutes les incidences, potentiellement délétères, venues heurter cette relation d’exception à tel ou tel méandre du destin de l’une ou de l’autre.
Le va-et-vient régulier, quasi rythmique, entre le déroulement banal, mondain, artificiel de l’événement-cadre et les rétrospections abruptement enclenchées par le surgissement, dans le champ de vision de la narratrice, de telle ou telle photographie, constitue une profonde, intime, émouvante, souvent douloureuse « recherche d’un temps perdu », sous la forme d’un puzzle narratif dont le lecteur est condamné à renouer les pièces, pouvant être non chronologiques, afin d’en dégager un quelconque sens global. Le fil de la mémoire n’est pas linéaire, il est discontinu, il comporte des trous, des éclipses, des occultations. La narratrice en est consciente, en souffre, craint que le souvenir ne soit pas conforme à la réalité vécue, « Le labyrinthe de la mémoire est déroutant », et cherche à rétablir une vérité dont une part tend inéluctablement à lui échapper.
L’exercice est multiplement passionnant, des fragments du parcours de chacune des quatre amies, de leurs ascendants vivants, de leurs relations s’insérant à la fois :
– dans des éléments narrativement épars du contexte historique chaotique d’un pays, la Géorgie, et de sa capitale Tbilissi, depuis l’éphémère République de 1918-1921 en passant par la période soviétique, les guerres russo-géorgiennes et les conflits séparatistes d’Ossétie et d’Abkhazie, jusqu’aux ultimes péripéties du roman, « Je ressentis de nouveau une sorte d’amour pour notre ville maltraitée, affligée, plongée dans le chaos, qui semblait n’avoir connu, depuis sa fondation, il y a plus d’un millénaire, que l’occupation, la libération, le sang et les larmes, la guerre et encore la guerre » ;
– entre des épisodes marquants des histoires particulières, parfois entre elles inextricablement imbriquées, des familles de toutes origines ethniques, de toutes religions, de tout statut social, de toutes professions, occupant les différents étages d’un immeuble ayant été divisé en micro-appartements à l’époque soviétique, donnant tous sur une cour intérieure commune, lieu central foisonnant où les résidents se croisent, se rassemblent, s’affrontent, s’aiment, grandissent, vieillissent, font fête ou expriment leurs deuils. Ce centre fourmillant de vies croisées rappelle Le passage des Miracles de Naguib Mahfouz, ou L’Immeuble Yacoubian d’Alaa El Aswany, ou encore l’ensemble immobilier devant lequel est installé Le banc de la victoire de François Momal ;
– entre les composantes sporadiquement relatées des intrigues complexes associant ou opposant, dans un pays où règne une absolue corruption, que dénonce la narratrice de manière virulente, de la base au sommet de la société, les milices de voyous imposant leur loi et leur « protection » aux commerçants et artisans des quartiers, bandes organisées dont sont membres, parfois dramatiquement rivaux, des parents et autres proches des quatre amies, « On sait tous que notre vie et tout ce pays sont un vaste mensonge ». « Tu sais parfaitement que n’importe quel idiot peut entrer à l’université et s’acheter une place ou même carrément un diplôme ».
Qui a lu le roman de Temur Babluani, Le Soleil, la lune et les champs de blé, publié au Cherche-Midi en janvier 2024, recensé dans le magazine de La Cause Littéraire en mars 2024, notera les similitudes narratives entre ce texte lui-même captivant, dont les intrigues se déroulent également à Tbilissi, et celui, poignant, qui est présenté ici.
Patryck Froissart
Nino Haratischwili est une auteure géorgienne-allemande, née en 1983 en Géorgie. Elle grandit dans un environnement où la culture et la littérature occupent une place centrale. Professionnellement, Nino Haratischwili se lance d’abord dans le théâtre, où elle écrit et met en scène plusieurs pièces qui rencontrent un succès notable. Elle se tourne ensuite vers l’écriture de romans, où elle trouve une nouvelle manière d’exprimer sa créativité et de toucher un public plus large. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve La Huitième Vie (pour Brilka) (2014), un roman épique qui retrace l’histoire d’une famille géorgienne sur plusieurs générations. D’autres œuvres notables dont Mon doux jumeau (2013), et Le Chat, le Général et la Corneille (2021), explorent des thèmes universels tels que l’amour, la perte et la quête d’identité. En plus de ses succès littéraires, elle est une voix influente dans les débats culturels et sociaux, utilisant sa plateforme pour aborder des questions importantes et défendre les droits de l’homme. Son engagement envers la justice sociale et son dévouement à l’art font d’elle une figure respectée.
- Vu : 2907
15:47 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Patryck Froissart: portrait rapide
15:45 Écrit par Patryck Froissart dans Biobibliographie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
14/01/2025
L'oeuvre de Dieu, la part du Diable - John Irving
| Titre critique | Le commentaire de Patryck Froissart |
| Étoiles |  |
| Date | 2010-12-12 @ 15:07:19 |
Critique:
Auteur: John Irving
Titre: L'oeuvre de Dieu, la part du Diable
Titre original: The cider house rules
Traduit de l'américain par Françoise et Guy Casaril
Editeur: Le Seuil (1986)
ISBN: 2-02-025780-7
733 pages
Le Dr Larch dirige un étrange établissement, dont la mission unique, la délivrance des femmes enceintes, recouvre deux réalités différentes.
En effet, le Dr Larch est à la fois un accoucheur et un avorteur.
Mais, dans les deux cas, les femmes qui arrivent dans son hôpital repartent sans progéniture. L'embryon retourne à la poussière, et le nouveau-né est immédiatement admis à l'orphelinat, qui fait partie des bâtiments, où il attend sa future famille adoptive.
L'oeuvre de Dieu, la part du diable: pour le Dr Larch, les deux vont de pair, et représentent, autant l'une que l'autre, des actes d'assistance à personnes en détresse.
Les avortements, étant illégaux, sont clandestins.
Le Dr Larch est aidé par deux fidèles infirmières qui lui sont totalement dévouées, à vie.
Toute cette activité s'installe vite dans une routine ponctuée de rites, jusqu'à ce qu'un des orphelins, Homer, se trouve tellement bien dans la compagnie du docteur et des deux nurses qu'il refuse, successivement, toutes les familles qui proposent de l'accueillir et de l'adopter.
Le roman nous conte, en alternance, la longue vie du Dr Larch à l'hôpital et celle, à l'orphelinat d'abord (où Homer finit par devenir l'assistant de celui qu'il considère comme son père) et dans une plantation de pommes ensuite (où Homer rejoint, vers ses vingt-cinq ans, un couple de son âge, Candy et Wally, dont il va partager la vie, le travail, et l'amour).
L'intrigue passionne, les personnages très marqués foisonnent, la liaison occulte de Candy et Homer d'une part, les sentiments qu'éprouvent l'un pour l'autre le Dr Larch et Homer d'autre part constituant le fil conducteur d'un roman à la fois décalé et réaliste.
Ce livre est de ceux dont on regrette toujours d'arriver à la dernière ligne...
Patryck Froissart, St Paul, le 12 décembre 2010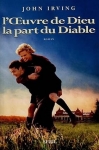
10:28 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|







