06/06/2025
Contredanses macabres: synopscènes
Contredanses macabres
Prolégomènes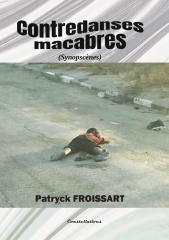
''L'homme est naturellement bon.'' Merci, Rousseau! Voilà un postulat qui m'a fait, lorsque je l'ai lu, une sacrée belle jambe!
Admettons.
Si Dieu existe, si l'homme est sa créature, si cet homme est naturellement bon, on en déduirait tout aussi naturellement que c'est Dieu qui l'a fait bon.
Or l'homme n'est pas bon, on le constate à longueur de temps.
''C'est la société qui le pervertit.'' Merci, Rousseau! Voilà un autre postulat qui m'a fait, lorsque je l'ai lu, une seconde sacrée belle jambe.
Fort de mes deux belles jambes rousseauistes, je me suis mis debout et j'ai voulu regarder Dieu en face, pour en savoir davantage, comme ont tenté de le faire en leur temps les personnages psychédéliques de Michel Lancelot.[1]
Je ne l'ai pas plus vu que Guy Béart ne l'a vu à Amsterdam.[2]
Alors je me le suis créé.
Je l'ai fait poétiquement, en usant, en abusant, certains diront en mésusant du Verbe, ce Verbe qui se serait fait Dieu (ou inversement) juste avant de créer le monde et de faire en sorte que la lumière fût.
Un Dieu-Verbe ne peut pas ne pas apprécier la poésie. Je lui dédie la mienne.
Ma poésie...
Pour me donner un genre.
Quelle poésie?
Classique?
A forme fixe?
Libérée?
Avec ou sans rimes?
Prose poétique?
Poésie prosaïque?
Je n'ai que faire de ces taxinomies. Je « fais » comme « ça » vient, en donnant du sens au son, et du son au sens.
Le verbe grec poïen qui est la racine étymologique de notre poésie, on le sait, se traduit en français par « faire ».
Or Aragon précise, avec raison, car le poète a toujours raison, que faire signifie chier.
Je verbifie. Je poétifie. Je « fais », à la va-comme-je-pousse. Je tartis mes pages.
Je « fais » le monde, tel que je le vois, tel que je le sens, pouah, tel que nous sommes tous en train de nous le pourrir, de nous le massacrer…
C'est, pour moi, une démarche de déconstipation mentale.
[1] Michel Lancelot – Je veux regarder Dieu en face – Ed. J'ai Lu (1972)
[2] Guy Béart – A Amsterdam - 1976
12:10 Écrit par Patryck Froissart dans Mes ouvrages publiés | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
31/05/2025
Olympe de Gouges, Une femme dans la Révolution, Florence Lotterie, Elise Pavy-Guilbert (par Patryck Froissart)
Olympe de Gouges, Une femme dans la Révolution, Florence Lotterie, Elise Pavy-Guilbert (par Patryck Froissart)
Olympe de Gouges, Une femme dans la Révolution, Florence Lotterie, Elise Pavy-Guilbert, Flammarion, février 2025, 176 pages, 22 €
Edition: Flammarion
- Vu : 376
12:02 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Coco perdu, Louis Guilloux (par Patryck Froissart)
Coco perdu, Louis Guilloux (par Patryck Froissart)
Coco perdu, Louis Guilloux, Folio, janvier 2025, 128 pages, 8 €
Ecrivain(s): Louis Guilloux Edition: Folio (Gallimard)
- Vu : 1078
12:01 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Cœur berbère, Habiba Benhayoune (par Patryck Froissart)
Cœur berbère, Habiba Benhayoune (par Patryck Froissart)
Cœur berbère, Habiba Benhayoune, Editions Ardemment, 2022, 210 pages, 19 €
- Vu : 652
12:00 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
L’étreinte Amicale, Marie de Gournay et Michel de Montaigne, Claire Tencin (par Patryck Froissart)
L’étreinte Amicale, Marie de Gournay et Michel de Montaigne, Claire Tencin (par Patryck Froissart)
L’étreinte Amicale, Marie de Gournay et Michel de Montaigne, Claire Tencin, Editions Infimes, janvier 2025, 200 pages, 15 €
Ecrivain(s): Claire Tencin
- Vu : 852
11:57 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Sade, l’insurrection permanente, Maurice Nadeau (par Patryck Froissart)
Sade, l’insurrection permanente, Maurice Nadeau (par Patryck Froissart)
Sade, l’insurrection permanente, suivi de Français, encore un effort si vous voulez être républicains, Maurice Nadeau, Ed. Maurice Nadeau, février 2025, 224 pages, 10,90 €
Edition: Editions Maurice Nadeau
- Vu : 911
11:56 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
L’Oiseau rouge, Mémoires d’une femme Dakota, Zitkàla-Sà (par Patryck Froissart)
L’Oiseau rouge, Mémoires d’une femme Dakota, Zitkàla-Sà (par Patryck Froissart)
L’Oiseau rouge, Mémoires d’une femme Dakota, Zitkàla-Sà, Editions Les Prouesses, octobre 2024, trad. anglais (USA), Marie Chuvin, 128 pages, 18 €
- Vu : 478
11:54 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Les Indignes, Agustina Bazterrica (par Patryck Froissart)
Les Indignes, Agustina Bazterrica (par Patryck Froissart)
Les Indignes, Agustina Bazterrica, Flammarion, janvier 2025, trad. espagnol (Argentine), Margot Nguyen Béraud, 190 pages, 21,50 €
Edition: Flammarion
- Vu : 672
11:52 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
09/05/2025
Grimus, Salman Rushdie (par Patryck Froissart)
Grimus, Salman Rushdie (par Patryck Froissart)
Grimus, Salman Rushdie, Gallimard Folio, 2023, trad. anglais, Maud Perrin, 471 pages, 9,40 €
Ecrivain(s): Salman Rushdie Edition: Folio (Gallimard)

Ce premier livre de Salman Rushdie, publié en 1977 et passé, inexplicablement, totalement inaperçu, a été traduit en français et édité chez Gallimard en août 2023.
Grimus est un roman torrent, un récit d’aventures au cours… aventureux, un écrit délire, un voyage onirique, une traversée du miroir, une transgression, un parcours aléatoire, une succession de sauts, sursauts, bonds et rebonds narratifs, un texte à tiroirs dont on cherche souvent, parfois vainement mais ceci participe de l’enchantement, les clés, et globalement un étourdissant mélange des genres. A la rigueur, si on veut absolument se hasarder à l’enfermer dans une typologie formelle, on peut considérer que l’ensemble des pérégrinations, péripéties, aventures et mésaventures dans lesquelles l’auteur ballotte le héros s’apparente à une épopée individuelle ou, si l’on veut, à une trajectoire odysséenne à quoi manquerait toutefois une Pénélope attendant le retour du voyageur.
L’histoire commence chez les Axona, une tribu amérindienne qui reste volontairement isolée du monde, quand une femme meurt en donnant le jour à un garçon, Joe-Sue, que le clan surnomme « Né-de-la-Mort » en raison de cet avènement funeste. Le père étant mort à son tour, l’enfant est élevé par sa grande sœur Louve Ailée qui le dépucelle en temps adéquat, qui se fait sa maîtresse spirituelle et sexuelle, et qui supporte de moins en moins l’ostracisme qui frappe les orphelins dans cette communauté, ce qui l’amène à rompre l’encloisonnement tribal pour des excursions de plus en plus fréquentes dans le monde extérieur, dont elle décrit les aspects attractifs à son frère lors de ses retours. C’est lors de ces fugues qu’elle reçoit à deux reprises d’un mystérieux vagabond, une fois pour elle, une seconde fois pour son frère, deux fioles contenant l’une un élixir jaune conférant l’immortalité, l’autre un liquide bleu pour éventuellement redevenir mortel. Louve Ailée ayant ingurgité la liqueur jaune fait découvrir la ville à son frère à qui elle attribue le nom de guerre « Aigle Errant », puis elle disparaît.
Aigle Errant, seul sous sa tente […] finit par déterrer le flacon jaune et le flacon bleu.
« Si je dois vivre en banni à l’Extérieur, autant m’octroyer une faveur », décida-t-il avant d’avaler le liquide jaune conservateur de vie qui avait un goût doux-amer.
Et voilà Aigle Errant projeté dans un périple au bout de quoi il échouera sept cents ans après sur la grève de l’île du Veau où sa destinée le conduira dans la ville de K (référence à Kafka, à Buzzati ?) peuplée d’autres immortels lassés de pérégriner, selon la prédiction de Deggle, l’un de ses mentors initiaux :
« Ils y vont tous de leur plein gré parce qu’ils ont choisi l’immortalité. Mais toi tu mènes un autre genre de quête : subir la vieillesse, la dégradation physiologique, éventuellement la mort au bout du compte. Tu vas sûrement foutre le bordel là-bas, Casanova. Sans parler de la prophétie de la vieille Livia ».
Ces prophéties se réaliseront-elles ? Suspense !
Car dès que le jeune Joe-Sue devenu immortel quitte la tribu, le cours narratif prend une allure débridée, des directions imprévisibles, passe par des déviations fantaisistes, des dérivations déconcertantes, des digressions paradoxales. L’imagination du destinateur s’emballe. Nous traversons l’espace et le temps. Par les failles, par les portes cosmiques, par les ponts qu’ouvre et instaure l’auteur, re-Créateur de cosmos, nous débarquons dans des mondes parallèles, autant dans les « Dimensions Extérieures » que dans « les Dimensions intérieures » du Soi, nous voyageons dans l’intergalactique et fréquentons une étrange planète lointaine (Ouille-Nerg, appelée aussi Erret) dont la raison de vivre des autochtones est la recherche passionnée d’anagrammes, nous rencontrons des personnages singuliers, des êtres charnels, minéraux ou ectoplasmiques, et nous sommes parties prenantes dans les diverses quêtes que mène simultanément, à perte de raison, Aigle Errant qui est incessamment à la recherche de sa sœur immortelle, qui s’évertue à trouver un sens à sa propre immortalité et à celle des personnages qu’il a croisés au cours de ses errances et qui se retrouvent tous confinés (pour l’éternité ?) dans l’île du Veau, qui cherche à percer le mystère de la raison d’être de ladite île et de la ville de K, qui décide de gravir, faisant fi de tous les dangers auxquels il s’expose et se prétendant prêt à relever tous les défis qui jalonnent l’ascension, la montagne centrale de l’île où l’attend de toute éternité un certain Grimus (anagramme de Simurg, divinité hindouiste assimilable à notre Phoenix) dont chaque protagoniste évoque le nom et les pouvoirs avec respect, crainte, circonspection ou… incrédulité.
« Si Dieu n’existait pas, il faudrait bien en inventer un, se rappela Virgil qui inversa aussitôt la proposition en la modifiant légèrement : puisqu’il existe un Grimus, il faut le détruire ».
Point culminant de ce long et périlleux roman d’apprentissage marqué de ruptures, de déceptions, de périodes de découragement, la montée du Pic de l’île évoque la récurrence multiculturelle et conséquemment intertextuelle du mythe de l’Ascension, de l’élévation spirituelle, et la résurgence de l’allégorie de la Montagne, cet Olympe, ce « Rocher inébranlable » sur lequel l’homme accompli bâtit sa demeure, ce lieu de rencontre entre l’homme et le divin (Mont Sinaï, Mont Tabor, Mont Nébo…), ce sommet sacré puissamment évoqué dans le Livre des Psaumes (Ps, 68 : 16-17) :
« Montagne de Dieu, la montagne de Bashân ! Montagne sourcilleuse, la montagne de Bashân ! Pourquoi jalouser, montagnes sourcilleuses, la montagne que Dieu a désirée pour séjour ? Oui, Yahvé y demeurera jusqu’à la fin… ».
C’est là-haut que se déroulera la rencontre décisive avec Grimus.
Dans le tissu de ce roman à la fois impétueux et méandreux, dans lequel pointent les éléments des futures œuvres de Rushdie, s’entrelacent des thèses philosophiques, des réflexions métaphysiques ponctuant une succession déjantée et une imbrication imprévisible de multiples genres et styles scripturaux : poésie, discours scientifique, argumentation, fantastique, science-fiction, anticipation, humour, réalisme, politique, aventures, suspense, voire thriller… et, épisode tiroir pouvant constituer un roman en soi : une histoire d’amour triangulaire, dramatique à souhait, entre Aigle Errant et les deux plus belles immortelles, évidemment rivales, de l’île du Veau ! Passage quasiment obligé pour ce bel Axona à qui le guide primordial Deggle promettait une vie de Casanova !
Allons ! Embarquement immédiat !
Patryck Froissart
Salman Rushdie, né le 19 juin 1947 à Bombay, est un écrivain britannique d’origine indienne. Son style narratif, mêlant mythe et fantaisie avec la vie réelle, a été qualifié de réalisme magique. Objet d’une fatwa de l’ayatollah Khomeini à la suite de la publication de son roman Les Versets sataniques (1988), il est devenu un symbole de la lutte pour la liberté d’expression et contre l’obscurantisme religieux. Il a publié une dizaine de romans, dans certains desquels on retrouve les influences de Günter Grass et de Mikhaïl Boulgakov, des essais et des nouvelles.
- Vu : 746
14:52 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
L’évidence de la paix nous enfante, Luminitza C. Tigirlas (par Patryck Froissart)
L’évidence de la paix nous enfante, Luminitza C. Tigirlas (par Patryck Froissart)
L’évidence de la paix nous enfante, Luminitza C. Tigirlas, Editions Al Manar, octobre 2024, 70 pages, 15 €
Edition: Al Manar

Un nouveau recueil de poésie de l’écrivaine de langue française, d’origine roumaine, Luminitza C. Tigirlas, qui vient s’ajouter à un corpus déjà fort important d’œuvres poétiques.
L’ouvrage comporte trois parties, dont les titres condensent les thèmes fondateurs d’une écriture traversée par les images obsédantes d’un passé constamment en résurgence dans l’ensemble des textes :
– ante bellum : les frontières saignent
– la paix envoie des perce-neige au front
– j’ai vu la terre pondre la faim
Exil
L’auteure, installée et insérée en France, est née en Moldavie orientale, « terre roumaine occupée et annexée par les Soviétiques ».
L’amertume du déracinement, d’un bannissement contraint, la nostalgie de la terre mère devenue indûment et étrangement étrangère, la souffrance latente due à la cruciale certitude d’avoir été injustement privée du droit de vivre là-bas, de développer son être dans ce lointain désormais révolu, dans cet environnement naturel, géographique, historique, social, culturel en quelque sorte utérin et à tout jamais impossible à retrouver, hantent l’écriture.
La terre de Moldova se tient au lointain
au temps d’une étrangeté grondante
d’un ciel banni trop haut
et d’un désir détenu à ses frontières
[…]
Prutul est une rivière
et je suis son bord
du côté de l’Est
toujours en saignement de frontières
Guerres
L’histoire mouvementée de la République de Moldova, tiraillée, de par la bi-diversité ethnico-culturelle de sa population, entre l’Europe et la Russie, laquelle l’a amputée d’une partie (la Transnistrie) de son territoire immémorial, histoire jalonnée de conflits funestes au sein d’une région perpétuellement en tension, connaît une nouvelle période tourmentée depuis le déclenchement de l’attaque militaire russe en Ukraine. L’auteure ressent en son âme, en sa chair, en ses tripes, les séquelles des ravages de ces guerres régionales passées et présentes, qui ont fait et font « saigner les frontières » et exprime à la fois son horreur de toute guerre quelle qu’elle soit et l’espérance de voir s’épanouir sur les champs de bataille des perce-neige aux blancs pétales messagers de paix qui marqueraient la fin des sombres saisons belligènes.
Espoir illusoire ? Le titre du volume semble porteur d’une perspective optimiste, de cette paix qui serait régénératrice, qui redonnerait vie, et dont il convient, malgré la sombreur de la strophe ci-dessous, de considérer la potentielle instauration comme une impérative « évidence ».
La paix envoie des perce-neige au front,
Leurs clochettes maculées de vert
Leurs têtes hébétées
Prennent feu
Dans les mains des enfants.
Ils ne grandiront plus au bord de Dnipro.
Langue
La soviétisation de la région natale de Luminitza s’est accompagnée d’une assimilation linguistique forcée. Les réminiscences de cette russification, et de l’incarcération de l’écriture de sa langue maternelle roumaine dans le système alphabétique cyrillique, provoquent chez cette auteure trilingue, de façon lancinante, ici la traduction récurrente d’une révolte à jamais douloureuse, et là la pénible évidence de la difficulté, voire de l’impossibilité de pouvoir exprimer parfois dans la langue qui est devenue sienne par immigration ce qui jaillit spontanément dans la langue originelle.
Striures de l’autre langue
sur la face du mot qui s’ouvre –
infinie matière du souffle
[…]
Striures dans la peau du langage
le français ploie, il s’est barricadé
face à une langue natale
langue revenue avec épaisseur
– intraduisible –
dans la tombée de ton silence
Quelques belles perles extraites d’une brillante guirlande d’images :
A la pente de l’Est
la blessure
fume dans la chair
des mots en décomposition
[…]
Faisant la moue
sous les masques à gaz nous grandîmes
dans la paix armée des Soviets
– écorces blanches des bouleaux –
[…]
Tout était autre
et la lumière avait l’air coupable
d’un enfant qui se blesse
avec un phonème
Et l’ensemble est à l’avenant : une poésie poignante, voire déchirante, de défoulement, d’exploration de soi, de réouvertures de blessures existentielles, une poésie propre à une auteure titulaire d’un doctorat en psychopathologie exerçant la profession de psychanalyste.
Patryck Froissart
Luminitza Claudepierre Tigirlas, d’origine roumaine, née en 1966, en Moldova orientale, est une survivante de l’assimilation linguistique soviétique. Poétesse et écrivaine de langue française après avoir d’abord écrit en roumain, elle a publié de nombreux recueils de poésie, des essais littéraires et des textes de fiction.
- Vu : 970
14:50 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|













