09/05/2025
Grimus, Salman Rushdie (par Patryck Froissart)
Grimus, Salman Rushdie (par Patryck Froissart)
Grimus, Salman Rushdie, Gallimard Folio, 2023, trad. anglais, Maud Perrin, 471 pages, 9,40 €
Ecrivain(s): Salman Rushdie Edition: Folio (Gallimard)

Ce premier livre de Salman Rushdie, publié en 1977 et passé, inexplicablement, totalement inaperçu, a été traduit en français et édité chez Gallimard en août 2023.
Grimus est un roman torrent, un récit d’aventures au cours… aventureux, un écrit délire, un voyage onirique, une traversée du miroir, une transgression, un parcours aléatoire, une succession de sauts, sursauts, bonds et rebonds narratifs, un texte à tiroirs dont on cherche souvent, parfois vainement mais ceci participe de l’enchantement, les clés, et globalement un étourdissant mélange des genres. A la rigueur, si on veut absolument se hasarder à l’enfermer dans une typologie formelle, on peut considérer que l’ensemble des pérégrinations, péripéties, aventures et mésaventures dans lesquelles l’auteur ballotte le héros s’apparente à une épopée individuelle ou, si l’on veut, à une trajectoire odysséenne à quoi manquerait toutefois une Pénélope attendant le retour du voyageur.
L’histoire commence chez les Axona, une tribu amérindienne qui reste volontairement isolée du monde, quand une femme meurt en donnant le jour à un garçon, Joe-Sue, que le clan surnomme « Né-de-la-Mort » en raison de cet avènement funeste. Le père étant mort à son tour, l’enfant est élevé par sa grande sœur Louve Ailée qui le dépucelle en temps adéquat, qui se fait sa maîtresse spirituelle et sexuelle, et qui supporte de moins en moins l’ostracisme qui frappe les orphelins dans cette communauté, ce qui l’amène à rompre l’encloisonnement tribal pour des excursions de plus en plus fréquentes dans le monde extérieur, dont elle décrit les aspects attractifs à son frère lors de ses retours. C’est lors de ces fugues qu’elle reçoit à deux reprises d’un mystérieux vagabond, une fois pour elle, une seconde fois pour son frère, deux fioles contenant l’une un élixir jaune conférant l’immortalité, l’autre un liquide bleu pour éventuellement redevenir mortel. Louve Ailée ayant ingurgité la liqueur jaune fait découvrir la ville à son frère à qui elle attribue le nom de guerre « Aigle Errant », puis elle disparaît.
Aigle Errant, seul sous sa tente […] finit par déterrer le flacon jaune et le flacon bleu.
« Si je dois vivre en banni à l’Extérieur, autant m’octroyer une faveur », décida-t-il avant d’avaler le liquide jaune conservateur de vie qui avait un goût doux-amer.
Et voilà Aigle Errant projeté dans un périple au bout de quoi il échouera sept cents ans après sur la grève de l’île du Veau où sa destinée le conduira dans la ville de K (référence à Kafka, à Buzzati ?) peuplée d’autres immortels lassés de pérégriner, selon la prédiction de Deggle, l’un de ses mentors initiaux :
« Ils y vont tous de leur plein gré parce qu’ils ont choisi l’immortalité. Mais toi tu mènes un autre genre de quête : subir la vieillesse, la dégradation physiologique, éventuellement la mort au bout du compte. Tu vas sûrement foutre le bordel là-bas, Casanova. Sans parler de la prophétie de la vieille Livia ».
Ces prophéties se réaliseront-elles ? Suspense !
Car dès que le jeune Joe-Sue devenu immortel quitte la tribu, le cours narratif prend une allure débridée, des directions imprévisibles, passe par des déviations fantaisistes, des dérivations déconcertantes, des digressions paradoxales. L’imagination du destinateur s’emballe. Nous traversons l’espace et le temps. Par les failles, par les portes cosmiques, par les ponts qu’ouvre et instaure l’auteur, re-Créateur de cosmos, nous débarquons dans des mondes parallèles, autant dans les « Dimensions Extérieures » que dans « les Dimensions intérieures » du Soi, nous voyageons dans l’intergalactique et fréquentons une étrange planète lointaine (Ouille-Nerg, appelée aussi Erret) dont la raison de vivre des autochtones est la recherche passionnée d’anagrammes, nous rencontrons des personnages singuliers, des êtres charnels, minéraux ou ectoplasmiques, et nous sommes parties prenantes dans les diverses quêtes que mène simultanément, à perte de raison, Aigle Errant qui est incessamment à la recherche de sa sœur immortelle, qui s’évertue à trouver un sens à sa propre immortalité et à celle des personnages qu’il a croisés au cours de ses errances et qui se retrouvent tous confinés (pour l’éternité ?) dans l’île du Veau, qui cherche à percer le mystère de la raison d’être de ladite île et de la ville de K, qui décide de gravir, faisant fi de tous les dangers auxquels il s’expose et se prétendant prêt à relever tous les défis qui jalonnent l’ascension, la montagne centrale de l’île où l’attend de toute éternité un certain Grimus (anagramme de Simurg, divinité hindouiste assimilable à notre Phoenix) dont chaque protagoniste évoque le nom et les pouvoirs avec respect, crainte, circonspection ou… incrédulité.
« Si Dieu n’existait pas, il faudrait bien en inventer un, se rappela Virgil qui inversa aussitôt la proposition en la modifiant légèrement : puisqu’il existe un Grimus, il faut le détruire ».
Point culminant de ce long et périlleux roman d’apprentissage marqué de ruptures, de déceptions, de périodes de découragement, la montée du Pic de l’île évoque la récurrence multiculturelle et conséquemment intertextuelle du mythe de l’Ascension, de l’élévation spirituelle, et la résurgence de l’allégorie de la Montagne, cet Olympe, ce « Rocher inébranlable » sur lequel l’homme accompli bâtit sa demeure, ce lieu de rencontre entre l’homme et le divin (Mont Sinaï, Mont Tabor, Mont Nébo…), ce sommet sacré puissamment évoqué dans le Livre des Psaumes (Ps, 68 : 16-17) :
« Montagne de Dieu, la montagne de Bashân ! Montagne sourcilleuse, la montagne de Bashân ! Pourquoi jalouser, montagnes sourcilleuses, la montagne que Dieu a désirée pour séjour ? Oui, Yahvé y demeurera jusqu’à la fin… ».
C’est là-haut que se déroulera la rencontre décisive avec Grimus.
Dans le tissu de ce roman à la fois impétueux et méandreux, dans lequel pointent les éléments des futures œuvres de Rushdie, s’entrelacent des thèses philosophiques, des réflexions métaphysiques ponctuant une succession déjantée et une imbrication imprévisible de multiples genres et styles scripturaux : poésie, discours scientifique, argumentation, fantastique, science-fiction, anticipation, humour, réalisme, politique, aventures, suspense, voire thriller… et, épisode tiroir pouvant constituer un roman en soi : une histoire d’amour triangulaire, dramatique à souhait, entre Aigle Errant et les deux plus belles immortelles, évidemment rivales, de l’île du Veau ! Passage quasiment obligé pour ce bel Axona à qui le guide primordial Deggle promettait une vie de Casanova !
Allons ! Embarquement immédiat !
Patryck Froissart
Salman Rushdie, né le 19 juin 1947 à Bombay, est un écrivain britannique d’origine indienne. Son style narratif, mêlant mythe et fantaisie avec la vie réelle, a été qualifié de réalisme magique. Objet d’une fatwa de l’ayatollah Khomeini à la suite de la publication de son roman Les Versets sataniques (1988), il est devenu un symbole de la lutte pour la liberté d’expression et contre l’obscurantisme religieux. Il a publié une dizaine de romans, dans certains desquels on retrouve les influences de Günter Grass et de Mikhaïl Boulgakov, des essais et des nouvelles.
- Vu : 746
14:52 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
L’évidence de la paix nous enfante, Luminitza C. Tigirlas (par Patryck Froissart)
L’évidence de la paix nous enfante, Luminitza C. Tigirlas (par Patryck Froissart)
L’évidence de la paix nous enfante, Luminitza C. Tigirlas, Editions Al Manar, octobre 2024, 70 pages, 15 €
Edition: Al Manar

Un nouveau recueil de poésie de l’écrivaine de langue française, d’origine roumaine, Luminitza C. Tigirlas, qui vient s’ajouter à un corpus déjà fort important d’œuvres poétiques.
L’ouvrage comporte trois parties, dont les titres condensent les thèmes fondateurs d’une écriture traversée par les images obsédantes d’un passé constamment en résurgence dans l’ensemble des textes :
– ante bellum : les frontières saignent
– la paix envoie des perce-neige au front
– j’ai vu la terre pondre la faim
Exil
L’auteure, installée et insérée en France, est née en Moldavie orientale, « terre roumaine occupée et annexée par les Soviétiques ».
L’amertume du déracinement, d’un bannissement contraint, la nostalgie de la terre mère devenue indûment et étrangement étrangère, la souffrance latente due à la cruciale certitude d’avoir été injustement privée du droit de vivre là-bas, de développer son être dans ce lointain désormais révolu, dans cet environnement naturel, géographique, historique, social, culturel en quelque sorte utérin et à tout jamais impossible à retrouver, hantent l’écriture.
La terre de Moldova se tient au lointain
au temps d’une étrangeté grondante
d’un ciel banni trop haut
et d’un désir détenu à ses frontières
[…]
Prutul est une rivière
et je suis son bord
du côté de l’Est
toujours en saignement de frontières
Guerres
L’histoire mouvementée de la République de Moldova, tiraillée, de par la bi-diversité ethnico-culturelle de sa population, entre l’Europe et la Russie, laquelle l’a amputée d’une partie (la Transnistrie) de son territoire immémorial, histoire jalonnée de conflits funestes au sein d’une région perpétuellement en tension, connaît une nouvelle période tourmentée depuis le déclenchement de l’attaque militaire russe en Ukraine. L’auteure ressent en son âme, en sa chair, en ses tripes, les séquelles des ravages de ces guerres régionales passées et présentes, qui ont fait et font « saigner les frontières » et exprime à la fois son horreur de toute guerre quelle qu’elle soit et l’espérance de voir s’épanouir sur les champs de bataille des perce-neige aux blancs pétales messagers de paix qui marqueraient la fin des sombres saisons belligènes.
Espoir illusoire ? Le titre du volume semble porteur d’une perspective optimiste, de cette paix qui serait régénératrice, qui redonnerait vie, et dont il convient, malgré la sombreur de la strophe ci-dessous, de considérer la potentielle instauration comme une impérative « évidence ».
La paix envoie des perce-neige au front,
Leurs clochettes maculées de vert
Leurs têtes hébétées
Prennent feu
Dans les mains des enfants.
Ils ne grandiront plus au bord de Dnipro.
Langue
La soviétisation de la région natale de Luminitza s’est accompagnée d’une assimilation linguistique forcée. Les réminiscences de cette russification, et de l’incarcération de l’écriture de sa langue maternelle roumaine dans le système alphabétique cyrillique, provoquent chez cette auteure trilingue, de façon lancinante, ici la traduction récurrente d’une révolte à jamais douloureuse, et là la pénible évidence de la difficulté, voire de l’impossibilité de pouvoir exprimer parfois dans la langue qui est devenue sienne par immigration ce qui jaillit spontanément dans la langue originelle.
Striures de l’autre langue
sur la face du mot qui s’ouvre –
infinie matière du souffle
[…]
Striures dans la peau du langage
le français ploie, il s’est barricadé
face à une langue natale
langue revenue avec épaisseur
– intraduisible –
dans la tombée de ton silence
Quelques belles perles extraites d’une brillante guirlande d’images :
A la pente de l’Est
la blessure
fume dans la chair
des mots en décomposition
[…]
Faisant la moue
sous les masques à gaz nous grandîmes
dans la paix armée des Soviets
– écorces blanches des bouleaux –
[…]
Tout était autre
et la lumière avait l’air coupable
d’un enfant qui se blesse
avec un phonème
Et l’ensemble est à l’avenant : une poésie poignante, voire déchirante, de défoulement, d’exploration de soi, de réouvertures de blessures existentielles, une poésie propre à une auteure titulaire d’un doctorat en psychopathologie exerçant la profession de psychanalyste.
Patryck Froissart
Luminitza Claudepierre Tigirlas, d’origine roumaine, née en 1966, en Moldova orientale, est une survivante de l’assimilation linguistique soviétique. Poétesse et écrivaine de langue française après avoir d’abord écrit en roumain, elle a publié de nombreux recueils de poésie, des essais littéraires et des textes de fiction.
- Vu : 970
14:50 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Lettres à Denise, Louis Aragon (par Patryck Froissart)
Lettres à Denise, Louis Aragon (par Patryck Froissart)
https://www.lacauselitteraire.fr/lettres-a-denise-louis-aragon-par-patryck-froissart
Lettres à Denise, Louis Aragon, éd. Maurice Nadeau Poche, novembre 2024, 95 pages, 8,90 €
Edition: Editions Maurice Nadeau
- Vu : 1050
14:45 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
20/01/2025
Marthe, roman, Les Sœurs Vatard, Joris-Karl Huysmans (par Patryck Froissart)
Marthe, roman, Les Sœurs Vatard, Joris-Karl Huysmans (par Patryck Froissart)
Marthe, roman, Les Sœurs Vatard, Huysmans, Folio Classique, octobre 2024, 544 pages, 9,40 €
Ecrivain(s): Joris-Karl Huysmans Edition: Folio (Gallimard)

Cette réédition est présentée, établie, préfacée et annotée par Francesca Guglielmi. La somme des deux romans est suivie d’une Chronologie détaillée, rédigée par Francesca Guglielmi et André Guyaux, d’une intéressante notice sur la genèse et la réception des deux ouvrages, et d’une importante et précieuse bibliographie.
Marthe
C’est « l’histoire d’une fille », terme ici socialement méprisant désignant au 19ème siècle une femme aux mœurs légères.
Le parcours narratif est relativement banal, fait d’une succession de promotions et de régressions dans l’échelle de la pauvreté sociale, de périodes stables pendant lesquelles toit, table, trousseau, lit, statut socio-économique et amant régulier et protecteur, voire proxénète (on supporte un temps ses coups, ses brimades, ses humiliations et l’obligation de subvenir à ses besoins financiers) semblent devoir s’imposer durablement, et de chutes et rechutes, progressives ou brutales, vers et dans la précarité, les privations, l’inconfort, jusqu’un état de misère d’autant plus durement ressenti qu’il succède à un épisode dont on éprouve, malgré « les illusions perdues », une nostalgie persistante, et dont on va s’efforcer de retrouver les aspects équivoques avec un autre partenaire, quitte à laisser choir dans un ruisseau de plus en plus glauque amour-propre, dignité, et reste de morale.
Mais si l’intrigue accroche, ce qui est le cas, ce n’est pas tant par la chaîne narrative des péripéties auxquelles est confrontée Marthe, dont l’existence chaotique, jusqu’au désir de suicide, attire irrésistiblement quelque empathie, que par le talent de l’auteur à les inscrire dans le contexte d’une réalité sociale, économique, historique qu’il (re)crée avec un extraordinaire souci du détail.
Car par ce premier roman achevé en 1876, censuré en France, par ce récit cruel des vicissitudes d’une prostituée aléatoire, Huysmans assure et assume sa place dans le mouvement naturaliste, réaliste, où se retrouvent Zola (Nana), Maupassant (Boule de suif), Edmond de Goncourt (La fille Élisa) et d’autres romanciers du dernier quart du XIXe siècle, une trentaine d’années après la parution de Splendeurs et misères des Courtisanes.
La singularité du roman de Huysmans tient d’une part à la sombreur des mises en situations, à la tonalité négative, très dépréciative, des représentations du peuple des bas quartiers, d’autre part au remarquable travail sur la langue auquel se livre l’auteur pour donner de façon maximalement pittoresque une expressive réalité à la société qu’il dépeint, telle qu’il la voit. En cela, Huysmans se montre plus « réaliste » que les romanciers cités plus haut, et son naturalisme atteint ce point extrême, paradoxal, d’un hyper-réalisme qui théâtralise les scènes de vie jusqu’à les rendre, à la lecture, pourrait-on dire, hyper fictionnelles. Quel tour de force ! Il ne transcrit pas « le » monde, il façonne, même si ce n’est pas là son dessein littéraire, « un » monde qu’il souhaite a priori rendre exactement conforme à celui qu’il s’applique à observer avec la lorgnette d’un professeur d’histoire naturelle. Et ce petit monde, ô magie, prend vie, trucule, s’agite, souffre, s’affronte, se déchire, se corrompt, vibre et fourmille en mini cour des miracles, se fait plus vrai que nature, tout en ayant pour fondement des descriptions couvrant des pages entières pouvant passer pour des articles d’encyclopédie : celle, scientifique, de la fabrication de perles artificielles (un des métiers de Marthe), celle, sociologique, du fonctionnement régulier des maisons closes (dont Huysmans était, avant ses crises aiguës de dévotion, de même que l’étaient Maupassant, Flaubert et autres, un visiteur assidu), celles, topographiques, anthropologiques, semblables à des compositions photographiques, de quartiers, rues, boutiques, commerces, avec les personnages les animant, et cetera.
Les sœurs Vatard
Après le roman de Marthe, brillant premier coup n’ayant toutefois pas eu immédiatement, en partie à cause de la censure, le succès escompté et assurément mérité, paraît en 1878 celui des Sœurs Vatard, dédicacé à Zola, beaucoup plus long, plus dense, plus riche, sur le même registre. Le talent de dramaturge de Huysmans confine ici au génie. Alors que Marthe était « le » personnage central, l’héroïne pivot autour de quoi tournait le manège des autres protagonistes, ce second roman, comme son titre le laisse entendre, s’articule sur deux sœurs, deux caractères contraires, dont la mise en contraste pourrait rappeler, la crudité des séquences sexuelles en moins, les Justine et Juliette de Sade.
Désirée l’aînée, la délurée et Céline la vergogneuse que l’auteur appelle volontiers « la petite » mènent toutes deux un parcours sentimental heurté.
Désirée, jouisseuse, d’un naturel noceur, a pour amants réguliers, après avoir été exploitée par une série de suborneurs, de godelureaux, de mirliflors, d’abord l’alphonse macho prénommé Auguste puis le peintre pusillanime Cyprien, deux personnages dont les caractères sont puissamment brossés par le romancier. Céline, irrésolue, tiraillée entre sa morale personnelle, l’éveil des sens, son dévouement pour un père exigeant et une mère impotente, l’exemple et les conseils parfois moralement subversifs de sa sœur dévoyée, et un romantisme à l’eau de rose, a pour amoureux transi l’ouvrier Anatole, et comme prétendant le petit-bourgeois Amédée que le père Vatard veut lui faire épouser.
L’usage de la langue populaire, de l’argot (évoquant, ici et là, le pittoresque brut de l’écriture de l’oublié Aristide Bruant dans La Loupiote) et de la représentation minutieuse de la réalité des lieux, des us, des occupations, des comportements, des techniques, atteint ici son summum.
Le double parcours narratif des sœurs comprend d’une part des épisodes au cours de quoi chacune poursuit sans l’autre sa propre intrigue, conflue d’autre part lors de parties communes avec les partenaires respectifs en foires, bistrots, bouchons, beuglants toujours situés cartographiquement dans un Paris reconstitué, et toujours dépeints avec une précision extrême, et a pour nœuds de croisement réguliers tantôt l’atelier de brochage (dont le fonctionnement et les relations entre employés sont bien sûr expliqués rationnellement par un Huysmans propriétaire et directeur dans la vie réelle d’un semblable atelier) où travaillent les sœurs Vatard et Anatole, où Auguste ne manque pas de venir faire son grabuge, tantôt la maison familiale des sœurs Vatard. Cette structure en alternance judicieusement mesurée fonctionne au mieux et fait de ce roman une œuvre qui mériterait d’être mieux (re)connue.
Une des questions prêtant à débat dans le Landerneau littéraire contemporain à propos de ces deux romans ferait passer Huysmans pour misogyne et pour porteur d’un certain mépris bourgeois pour les membres des catégories sociales mises en scènes… S’il est vrai que l’image de la femme est ici la plupart du temps négative, les portraits d’hommes ne sont pas eux-mêmes positifs, s’il est certain que les tableaux des mœurs et coutumes des quartiers choisis sont généralement déprisants, si les propos et les faits et gestes des personnages secondaires peuvent paraître ici et là outrancièrement grossiers, si le style global a été publiquement dit « vulgaire » par Flaubert, il appartient à chaque lecteur, à chaque lectrice, de se faire ou non son propre jugement après avoir, quoi qu’il en soit, goûté une lecture savoureuse.
Patryck Froissart
Joris-Karl Huysmans est un auteur et critique d’art français. Il fit toute sa carrière au ministère de l’Intérieur, où il entra en 1866. En tant que romancier et critique d’art, il prit une part active à la vie littéraire et artistique française dans le dernier quart du XIXe siècle et jusqu’à sa mort.
- Vu : 426
15:48 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
La Lumière vacillante, Nino Haratischwili (par Patryck Froissart)
La Lumière vacillante, Nino Haratischwili (par Patryck Froissart)
https://www.lacauselitteraire.fr/la-lumiere-vacillante-ni...
La Lumière vacillante, Nino Haratischwili, Gallimard, Coll. du monde entier, septembre 2024, trad. allemand, Barbara Fontaine, 720 pages, 27,50 €
Edition: Gallimard

Voici un roman fleuve qui n’est certainement pas un long fleuve tranquille.
Après La Huitième vie, une fresque de 1200 pages présentée dans notre magazine en octobre 2021, Nino Haratischwili récidive avec ce carrousel romanesque de plus de 700 pages, servi comme le précédent ouvrage par la remarquable traduction de Barbara Fontaine.
Le prétexte, ou le sous-texte, ou le texte-cadre, est une exposition posthume, à Bruxelles, en 2019, des photos réalisées tout au long de sa vie par la célèbre photographe géorgienne Dina, l’un des personnages de premier plan de ce roman à l’écriture prolifique. Parmi les visiteurs se retrouvent Keto, la narratrice, Ira et Nene, les trois amies indéfectibles, depuis l’école primaire, de la défunte artiste dont l’absence hante, lancinante, la mémoire des protagonistes.
« Et mon corps la recherche, je me tends vers quelque chose qui ne vient pas, qui ne viendra plus jamais, et je persiste dans cette posture tandis que les gens, autour de moi, se dissolvent dans la musique. Mon corps me signale que son absence est une injustice criante, un scandale dont je ne veux pas m’accommoder ».
Entre deux échanges tantôt avec l’une, tantôt avec l’autre, tantôt avec ses deux amies d’enfance, Keto passe en revue la galerie de photos, s’arrêtant impulsivement devant celles qui réveillent brusquement, parfois même brutalement, des souvenirs, heureux pour certains, le plus souvent violents, de leur vie à Tbilissi, depuis leur enfance jusqu’à la mort tragique de Dina, événement qui a coïncidé avec une relative disjonction du cours jusque-là étroitement confluent de leurs quatre existences, cours toutefois, naturellement, jalonné de disputes, de désaccords, de réconciliations, et ponctuellement de réaffirmations d’une sororité se révélant finalement plus forte que toutes les incidences, potentiellement délétères, venues heurter cette relation d’exception à tel ou tel méandre du destin de l’une ou de l’autre.
Le va-et-vient régulier, quasi rythmique, entre le déroulement banal, mondain, artificiel de l’événement-cadre et les rétrospections abruptement enclenchées par le surgissement, dans le champ de vision de la narratrice, de telle ou telle photographie, constitue une profonde, intime, émouvante, souvent douloureuse « recherche d’un temps perdu », sous la forme d’un puzzle narratif dont le lecteur est condamné à renouer les pièces, pouvant être non chronologiques, afin d’en dégager un quelconque sens global. Le fil de la mémoire n’est pas linéaire, il est discontinu, il comporte des trous, des éclipses, des occultations. La narratrice en est consciente, en souffre, craint que le souvenir ne soit pas conforme à la réalité vécue, « Le labyrinthe de la mémoire est déroutant », et cherche à rétablir une vérité dont une part tend inéluctablement à lui échapper.
L’exercice est multiplement passionnant, des fragments du parcours de chacune des quatre amies, de leurs ascendants vivants, de leurs relations s’insérant à la fois :
– dans des éléments narrativement épars du contexte historique chaotique d’un pays, la Géorgie, et de sa capitale Tbilissi, depuis l’éphémère République de 1918-1921 en passant par la période soviétique, les guerres russo-géorgiennes et les conflits séparatistes d’Ossétie et d’Abkhazie, jusqu’aux ultimes péripéties du roman, « Je ressentis de nouveau une sorte d’amour pour notre ville maltraitée, affligée, plongée dans le chaos, qui semblait n’avoir connu, depuis sa fondation, il y a plus d’un millénaire, que l’occupation, la libération, le sang et les larmes, la guerre et encore la guerre » ;
– entre des épisodes marquants des histoires particulières, parfois entre elles inextricablement imbriquées, des familles de toutes origines ethniques, de toutes religions, de tout statut social, de toutes professions, occupant les différents étages d’un immeuble ayant été divisé en micro-appartements à l’époque soviétique, donnant tous sur une cour intérieure commune, lieu central foisonnant où les résidents se croisent, se rassemblent, s’affrontent, s’aiment, grandissent, vieillissent, font fête ou expriment leurs deuils. Ce centre fourmillant de vies croisées rappelle Le passage des Miracles de Naguib Mahfouz, ou L’Immeuble Yacoubian d’Alaa El Aswany, ou encore l’ensemble immobilier devant lequel est installé Le banc de la victoire de François Momal ;
– entre les composantes sporadiquement relatées des intrigues complexes associant ou opposant, dans un pays où règne une absolue corruption, que dénonce la narratrice de manière virulente, de la base au sommet de la société, les milices de voyous imposant leur loi et leur « protection » aux commerçants et artisans des quartiers, bandes organisées dont sont membres, parfois dramatiquement rivaux, des parents et autres proches des quatre amies, « On sait tous que notre vie et tout ce pays sont un vaste mensonge ». « Tu sais parfaitement que n’importe quel idiot peut entrer à l’université et s’acheter une place ou même carrément un diplôme ».
Qui a lu le roman de Temur Babluani, Le Soleil, la lune et les champs de blé, publié au Cherche-Midi en janvier 2024, recensé dans le magazine de La Cause Littéraire en mars 2024, notera les similitudes narratives entre ce texte lui-même captivant, dont les intrigues se déroulent également à Tbilissi, et celui, poignant, qui est présenté ici.
Patryck Froissart
Nino Haratischwili est une auteure géorgienne-allemande, née en 1983 en Géorgie. Elle grandit dans un environnement où la culture et la littérature occupent une place centrale. Professionnellement, Nino Haratischwili se lance d’abord dans le théâtre, où elle écrit et met en scène plusieurs pièces qui rencontrent un succès notable. Elle se tourne ensuite vers l’écriture de romans, où elle trouve une nouvelle manière d’exprimer sa créativité et de toucher un public plus large. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve La Huitième Vie (pour Brilka) (2014), un roman épique qui retrace l’histoire d’une famille géorgienne sur plusieurs générations. D’autres œuvres notables dont Mon doux jumeau (2013), et Le Chat, le Général et la Corneille (2021), explorent des thèmes universels tels que l’amour, la perte et la quête d’identité. En plus de ses succès littéraires, elle est une voix influente dans les débats culturels et sociaux, utilisant sa plateforme pour aborder des questions importantes et défendre les droits de l’homme. Son engagement envers la justice sociale et son dévouement à l’art font d’elle une figure respectée.
- Vu : 2907
15:47 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Patryck Froissart: portrait rapide
15:45 Écrit par Patryck Froissart dans Biobibliographie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
14/01/2025
L'oeuvre de Dieu, la part du Diable - John Irving
| Titre critique | Le commentaire de Patryck Froissart |
| Étoiles |  |
| Date | 2010-12-12 @ 15:07:19 |
Critique:
Auteur: John Irving
Titre: L'oeuvre de Dieu, la part du Diable
Titre original: The cider house rules
Traduit de l'américain par Françoise et Guy Casaril
Editeur: Le Seuil (1986)
ISBN: 2-02-025780-7
733 pages
Le Dr Larch dirige un étrange établissement, dont la mission unique, la délivrance des femmes enceintes, recouvre deux réalités différentes.
En effet, le Dr Larch est à la fois un accoucheur et un avorteur.
Mais, dans les deux cas, les femmes qui arrivent dans son hôpital repartent sans progéniture. L'embryon retourne à la poussière, et le nouveau-né est immédiatement admis à l'orphelinat, qui fait partie des bâtiments, où il attend sa future famille adoptive.
L'oeuvre de Dieu, la part du diable: pour le Dr Larch, les deux vont de pair, et représentent, autant l'une que l'autre, des actes d'assistance à personnes en détresse.
Les avortements, étant illégaux, sont clandestins.
Le Dr Larch est aidé par deux fidèles infirmières qui lui sont totalement dévouées, à vie.
Toute cette activité s'installe vite dans une routine ponctuée de rites, jusqu'à ce qu'un des orphelins, Homer, se trouve tellement bien dans la compagnie du docteur et des deux nurses qu'il refuse, successivement, toutes les familles qui proposent de l'accueillir et de l'adopter.
Le roman nous conte, en alternance, la longue vie du Dr Larch à l'hôpital et celle, à l'orphelinat d'abord (où Homer finit par devenir l'assistant de celui qu'il considère comme son père) et dans une plantation de pommes ensuite (où Homer rejoint, vers ses vingt-cinq ans, un couple de son âge, Candy et Wally, dont il va partager la vie, le travail, et l'amour).
L'intrigue passionne, les personnages très marqués foisonnent, la liaison occulte de Candy et Homer d'une part, les sentiments qu'éprouvent l'un pour l'autre le Dr Larch et Homer d'autre part constituant le fil conducteur d'un roman à la fois décalé et réaliste.
Ce livre est de ceux dont on regrette toujours d'arriver à la dernière ligne...
Patryck Froissart, St Paul, le 12 décembre 2010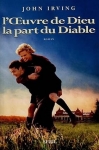
10:28 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
30/11/2024
La femme minérale, chronique de Patryck Froissart
La femme minérale, Nathalie Bénézet (par Patryck Froissart)
La femme minérale, Nathalie Bénézet, Editions Maurice Nadeau, Les Lettres Nouvelles, mai 2024, 110 pages, 17 €

De retour, en Provence, d’un séjour professionnel de plusieurs années en Asie, le personnage principal de ce court roman, une femme alors désœuvrée, tombe par le plus aléatoire des hasards, dans la rubrique hétéroclite des faits divers, sur un article d’un quotidien local relatif au retrait, par décision judiciaire, à un couple totalement démuni de ressources, de ses deux enfants au motif allégué de maltraitance.
Les autorités ayant investi le taudis dans lequel la famille vivait en totale réclusion, tous volets clos, sans contact avec l’environnement social, y auraient découvert les jumeaux déscolarisés, désocialisés, dénutris, en manque de soins.
« Pendant des jours, j’ai pensé à ces gens. […] J’ai pensé à eux comme s’ils étaient des proches. Et je les imaginais seuls, sans les petits, sans plus le droit de ni les n’approcher ni de les voir, jamais ».
Irrésistiblement prise d’une étrange sidération par cette affaire, la narratrice se mettant immédiatement à la recherche du couple avec qui elle désire, sans savoir elle-même pourquoi, entrer en relation, fait la connaissance de Samuel, l’avocat de la famille, avec qui, au fil de sa quête, elle noue une liaison amoureuse.
On découvrira, adroitement esquissées, imbriquées dans la trame romanesque, des bribes de l’histoire personnelle de la narratrice, son bout de chemin avec Patrick, un homme abandonné à sa naissance, un accident ayant décimé sa famille à l’exception du père ; on devine dans ces éléments narratifs le manque, un vide à combler qui pourrait jeter quelque éclairage sur cette étrange démarche dans laquelle elle s’engage à fond malgré les messages sarcastiques que lui envoie sa conscience, ici formalisée sous l’apparence d’une couleuvre virtuelle.
Moyennant une enquête difficile mais opiniâtre, la narratrice retrouve le couple, et, après maintes tentatives d’approche infructueuses, réussit à gagner sa confiance, bien que Joël, taiseux, et Constance, totalement mutique, fermée, impénétrable, éteinte, inerte, statufiée, « femme minérale », restent murés dans une tour de souffrance dont l’auteure a le pouvoir de nous faire ressentir le caractère poignant, lancinant, et irrémédiable.
Constance et Joël sont alors en attente de la révision du jugement, contre quoi ils ont déposé un recours en appel, qui les a privés de leurs droits parentaux. Récusant le terme de « maltraitance », ils en demandent la suppression afin que les jumeaux, parvenus à l’âge de vouloir savoir pourquoi ils leur ont été enlevés, ne se méprennent pas sur les causes du placement.
Et voilà que, face au juge, au procureur, à un public hostile et méprisant, soudainement, la statue s’anime, se dresse, se fait femme, devient mère, se livre, se délivre, ose défier, dans sa douleur qui explose, le tribunal, la salle, la société !
« Mon mari et moi, on les a aimés, les jumeaux, et on les aimera toujours »
[…]
Constance, avec un air de défi :
« Maltraitance, ça dit pas la vérité ».
Le procureur, sans que le président lui ait accordé la parole :
« Quelle vérité ? »
Constance :
« C’est pas parce qu’on aime un enfant qu’on sait forcément comment il faut faire pour l’élever. Ça s’apprend. Nous, on n’a pas appris ».
La vérité, bonnes gens, la voilà, toute nue, toute crue, la réalité sur laquelle l’auteure met le doigt et appuie fort, et ça fait mal au lecteur : la chute, lente mais continue, dans l’enfer de la misère dont on n’a plus l’espoir de sortir, le non-accompagnement, l’isolement, le cloisonnement, volontaire, par peur, par honte, de la cellule familiale, l’indifférence et l’incompréhension du voisinage, la résignation, le renoncement, l’ensemble constituant une sorte de suicide social ayant pour aboutissement une terrible sanction, la stricte et glaciale application d’une mesure de justice administrative méthodiquement dépourvue d’humanité.
C’est le message qu’envoie ce texte.
Après le verdict en appel, les protagonistes se séparent. Constance et Joël retournent dans le monde du silence, dans l’anonymat, dans l’inexistence de fait. Quant à la narratrice, cette tranche de vie douloureuse, quasiment initiatique, provoque en elle le besoin soudain de revoir un père avec qui elle avait rompu quelque temps après le dramatique épisode ayant décimé la parentèle.
« Tant d’années sans se voir. Et à présent, cette envie pressante de le sentir, là, physiquement, une envie de petite fille, impérieuse, presque vitale ».
Une lecture psychanalytique du texte devrait permettre de dégager le rapport entre l’histoire vécue par la narratrice avec Constance et Joël et son désir consécutif de se recréer une famille.
Patryck Froissart
Nathalie Bénézet, née en 1965, a beaucoup voyagé à l’étranger comme chargée de mission de l’Association ATD Quart Monde dont elle dirige aujourd’hui le Centre de Mémoire et de Recherche Joseph Wresinski. Elle a publié Les Moissons de l’absence (2016) et Mon pays c’est le chemin (2018) aux éditions Chèvre-Feuille étoilée. La femme minérale est son troisième roman.
- Vu : 646
13:07 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
26/09/2024
La fille verticale, Félicia Viti (par Patryck Froissart)
La fille verticale, Félicia Viti (par Patryck Froissart)
La fille verticale, Félicia Viti, Gallimard, Coll. Blanche, août 2024, 112 pages, 15,50 €
Edition: Gallimard

C’est l’histoire d’une passion amoureuse entre deux femmes, la narratrice et L. (Elle, tout simplement).
A priori, une intrigue en cours de banalisation dans la littérature contemporaine.
Ce roman court de Félicia Viti sort du lot. La relation entre les deux femmes est houleuse, faite d’une succession de querelles souvent triviales, de vraies et feintes ruptures, de réconciliations sensuellement torrides. L. disparaît, rejoint la faune nébuleuse des noctambules, fêtards, soûlards et drogués des quartiers interlopes de Paris, reparaît abruptement, s’impose, rompt à nouveau, fuyante, inconstante, ne supportant pas l’idée même de stabilité, de confort, ne tenant pas en place, sans cesse en mouvement, ce qui lui vaut cette appellation de « fille verticale ».
« C’est quoi une fille verticale ? C’est la fille contraire à la fille horizontale. A celle qui se couche et qui donne son corps et qui dit je t’aime. La fille verticale c’est celle qui vous tourne le dos quand elle met ses chaussures et qui vous regarde comme un étranger quand elle se réveille. Qui refuse de dîner avec vous, qui s’enfuit quand vous la poursuivrez, qui veut que vous la poursuiviez pour rester debout. La fille verticale c’est une fille qui s’envole dans l’air… ».
Le récit, formé d’un écheveau de courtes scènes, de brèves péripéties, d’états d’âme relatifs à des bouffées émotionnelles circonstancielles, ponctuelles, d’épisodes dramatiques, de souvenirs de jeunesse plus ou moins éclairants, accroche, bien que ces éléments constitutifs soient souvent, apparemment, en disjonction les uns par rapport aux autres, et retient autant que la construction narrative d’un roman linéaire courant. Point n’est besoin pour le lecteur de renouer des fils dont il connaît le dénouement dès le début du récit. La force originale de l’auteure consiste en le développement rapide d’une atmosphère impressionniste que la brièveté assumée des tableaux brossés eux-mêmes de courtes phrases, de touches rapides, de visions et de sensations se succédant comme autant de coups de pinceaux et de coups de couteaux (de poignards, de scalpels ?) contribue d’autant plus à installer et à entretenir qu’elle est littérairement soutenue par un art poétique d’une efficacité impressive remarquable. Il est à noter que par contraste avec l’essence poétique de l’écriture, les fragments narratifs sont contextualisés dans une contemporanéité réaliste, dont on retiendra en particulier la période du confinement consécutif à la pandémie de Covid-19…
L’écriture, qui n’est pas, par certains passages très crus, sans rappeler celle d’une des pionnières du genre romanesque des amours saphiques tragiques, Violette Leduc (Ravages), est en effet à forte dominante poétique, particulièrement lorsqu’elle respire la nostalgie, le regret, la souffrance, la colère, le désastre, le reproche, ou toute autre atteinte d’intense exaltation, jusqu’au paradoxal et antiphrastique aveu, de la part de l’auteure, de l’impossibilité d’exprimer, de traduire, de communiquer l’intime, d’être comprise.
« L’amour c’est un adieu qui insiste. Une plaie d’or dans le thorax. Je ne ferai pas l’effort de vous donner les clés de ce qu’a été le mien. Il n’y en a pas. Les serrures resteront fermées. Une pépite d’or sur la clé d’un tombeau. Vous n’y entrerez pas. Comme moi vous chercherez à l’attraper. Le saisir. Le tordre.
Et sans succès, il vous faudra juste vous atteler à suivre la même chose que moi.
Elle ».
Patryck Froissart
Félicia Viti est une romancière française, scénariste et réalisatrice pour la télévision. Elle a notamment co-écrit et co-réalisé la série Back to Corsica pour France-TV.
- Vu : 320
09:17 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Aux ventres des femmes, Huriya (par Patryck Froissart)
Aux ventres des femmes, Huriya (par Patryck Froissart)
Aux ventres des femmes, Huriya, Editions Rue de l’Echiquier, août 2024, 320 pages, 22 €

Après Entre les jambes, publié en avril 2021, un premier roman contestataire, provocateur, qui lui a apporté une immédiate notoriété, Huriya, écrivaine franco-marocaine, récidive avec ce récit tout autant percutant des quinze premières années de l’existence quotidienne de la fille cadette d’un boucher polygame et tyrannique tirant des préceptes de l’intégrisme islamique la légitimité de son odieux comportement domestique.
L’histoire se déroule dans un état islamique non identifié, dans le quotidien de quoi on peut reconnaître ici et là des éléments socio-culturels, socio-religieux, socio-linguistiques propres à telle ou telle communauté régionale du monde arabo-musulman.
Shahrazade, narratrice et héroïne du roman, dernière-née d’une cohorte de huit filles à qui la troisième épouse du boucher n’a pu, de même que les deux premières, à la grande fureur dudit mari, donner un héritier mâle, Shahrazade, rejetée, méprisée par son père qui la tient pour un être inachevé puisque non pourvu des attributs masculins qui font la fierté et l’honneur d’un respectable chef de famille, dénonce, en mettant en lumière les détails les plus intimes, les plus triviaux, les plus scabreux, voire les plus sordides des relations interfamiliales, l’hypocrisie d’une morale religieuse de façade, l’emprise infernale d’un système patriarcal conforme à de prétendus commandements divins n’accordant à la femme qu’un devoir absolu d’obéissance aux décisions de l’homme, aussi arbitraires, cruelles, iniques soient-elles, avec, pour corollaire, l’obligation de se plier à ses moindres désirs, à ses caprices, à ses vices, à ses sévices, sans un battement de cil de rébellion.
« Tu dois obéir !
Pourquoi ?
Parce que tu es une femme !
[…]
Dès leur plus jeune âge, on façonne les filles pour que leur esprit soit docile. Nées punies, on leur enseigne à accepter leur condition et on les dresse à obéir. Une femme se soumet, point ! Voilà ce que les lois froides de nos contrées ont fait de nous ».
Dans cette société cloisonnée faite d’une juxtaposition de dictatures domestiques exercées sur la femme, Shahrazade, possible lointaine et subtile réincarnation de celle qui sut vaincre à sa manière le despotisme délirant de Schahriar, Shahrazade, dès qu’elle est en âge de comprendre l’absurde iniquité de la condition de ses mère, tantes et sœurs, ose questionner, demander raison, protester malgré la certitude d’en être immédiatement et impitoyablement châtiée par le tyran.
Jusqu’à l’extrême point de rupture.
« Un jour je sortirai de l’arbre généalogique. Je ne suis pas née dans la bonne famille. Ma place n’est pas ici ».
Roman fort bien écrit, objectivement fondé sur des situations sociales bien réelles, construit sur une succession de péripéties poignantes s’inscrivant dans l’atmosphère ténébreuse d’une cellule microcosmique dont les éléments interagissent de façon socialement occulte entre quatre murs dans une tension croissante, ce deuxième ouvrage de Huriya est à rapprocher de celui de l’écrivaine française d’origine marocaine Kaoutar Harchi, A l’origine, notre père obscur (Actes Sud 2016) et de celui de R. K. Narayan, Dans la chambre obscure (Zulma 2014), dont le dessein est semblablement de lever le voile sur les effets tragiques, insupportables, des intégrismes religieux, sur l’aberration ignominieuse des hommes qui en appliquent les principes, ces êtres inhumains dont une des protagonistes âgées du présent récit se demande avec désespoir d’où a surgi l’engeance.
« Et dire que je les ai connus à la mamelle et que j’ai bercé sur mes genoux des enfants devenus des diables ! Mais comment ont-ils sombré dans l’horreur ?
[…] Ces hommes ont prêté serment d’allégeance au Diable.
– Où est Dieu ?
– Dieu s’est enfui ! »
Patryck Froissart
Huriya est née et a grandi à Marrakech. A dix-sept ans, elle quitte le Maroc pour la France, où elle entreprend des études de philosophie. Elle est l’auteure d’une dizaine de romans sur la pauvreté, la banlieue et les migrations, publiés sous pseudonyme. Elle a aujourd’hui deux passeports, deux identités, et deux pays, puisqu’elle partage son temps entre le Maroc et la France.
09:16 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|








