20/01/2025
La Lumière vacillante, Nino Haratischwili (par Patryck Froissart)
La Lumière vacillante, Nino Haratischwili (par Patryck Froissart)
https://www.lacauselitteraire.fr/la-lumiere-vacillante-ni...
La Lumière vacillante, Nino Haratischwili, Gallimard, Coll. du monde entier, septembre 2024, trad. allemand, Barbara Fontaine, 720 pages, 27,50 €
Edition: Gallimard

Voici un roman fleuve qui n’est certainement pas un long fleuve tranquille.
Après La Huitième vie, une fresque de 1200 pages présentée dans notre magazine en octobre 2021, Nino Haratischwili récidive avec ce carrousel romanesque de plus de 700 pages, servi comme le précédent ouvrage par la remarquable traduction de Barbara Fontaine.
Le prétexte, ou le sous-texte, ou le texte-cadre, est une exposition posthume, à Bruxelles, en 2019, des photos réalisées tout au long de sa vie par la célèbre photographe géorgienne Dina, l’un des personnages de premier plan de ce roman à l’écriture prolifique. Parmi les visiteurs se retrouvent Keto, la narratrice, Ira et Nene, les trois amies indéfectibles, depuis l’école primaire, de la défunte artiste dont l’absence hante, lancinante, la mémoire des protagonistes.
« Et mon corps la recherche, je me tends vers quelque chose qui ne vient pas, qui ne viendra plus jamais, et je persiste dans cette posture tandis que les gens, autour de moi, se dissolvent dans la musique. Mon corps me signale que son absence est une injustice criante, un scandale dont je ne veux pas m’accommoder ».
Entre deux échanges tantôt avec l’une, tantôt avec l’autre, tantôt avec ses deux amies d’enfance, Keto passe en revue la galerie de photos, s’arrêtant impulsivement devant celles qui réveillent brusquement, parfois même brutalement, des souvenirs, heureux pour certains, le plus souvent violents, de leur vie à Tbilissi, depuis leur enfance jusqu’à la mort tragique de Dina, événement qui a coïncidé avec une relative disjonction du cours jusque-là étroitement confluent de leurs quatre existences, cours toutefois, naturellement, jalonné de disputes, de désaccords, de réconciliations, et ponctuellement de réaffirmations d’une sororité se révélant finalement plus forte que toutes les incidences, potentiellement délétères, venues heurter cette relation d’exception à tel ou tel méandre du destin de l’une ou de l’autre.
Le va-et-vient régulier, quasi rythmique, entre le déroulement banal, mondain, artificiel de l’événement-cadre et les rétrospections abruptement enclenchées par le surgissement, dans le champ de vision de la narratrice, de telle ou telle photographie, constitue une profonde, intime, émouvante, souvent douloureuse « recherche d’un temps perdu », sous la forme d’un puzzle narratif dont le lecteur est condamné à renouer les pièces, pouvant être non chronologiques, afin d’en dégager un quelconque sens global. Le fil de la mémoire n’est pas linéaire, il est discontinu, il comporte des trous, des éclipses, des occultations. La narratrice en est consciente, en souffre, craint que le souvenir ne soit pas conforme à la réalité vécue, « Le labyrinthe de la mémoire est déroutant », et cherche à rétablir une vérité dont une part tend inéluctablement à lui échapper.
L’exercice est multiplement passionnant, des fragments du parcours de chacune des quatre amies, de leurs ascendants vivants, de leurs relations s’insérant à la fois :
– dans des éléments narrativement épars du contexte historique chaotique d’un pays, la Géorgie, et de sa capitale Tbilissi, depuis l’éphémère République de 1918-1921 en passant par la période soviétique, les guerres russo-géorgiennes et les conflits séparatistes d’Ossétie et d’Abkhazie, jusqu’aux ultimes péripéties du roman, « Je ressentis de nouveau une sorte d’amour pour notre ville maltraitée, affligée, plongée dans le chaos, qui semblait n’avoir connu, depuis sa fondation, il y a plus d’un millénaire, que l’occupation, la libération, le sang et les larmes, la guerre et encore la guerre » ;
– entre des épisodes marquants des histoires particulières, parfois entre elles inextricablement imbriquées, des familles de toutes origines ethniques, de toutes religions, de tout statut social, de toutes professions, occupant les différents étages d’un immeuble ayant été divisé en micro-appartements à l’époque soviétique, donnant tous sur une cour intérieure commune, lieu central foisonnant où les résidents se croisent, se rassemblent, s’affrontent, s’aiment, grandissent, vieillissent, font fête ou expriment leurs deuils. Ce centre fourmillant de vies croisées rappelle Le passage des Miracles de Naguib Mahfouz, ou L’Immeuble Yacoubian d’Alaa El Aswany, ou encore l’ensemble immobilier devant lequel est installé Le banc de la victoire de François Momal ;
– entre les composantes sporadiquement relatées des intrigues complexes associant ou opposant, dans un pays où règne une absolue corruption, que dénonce la narratrice de manière virulente, de la base au sommet de la société, les milices de voyous imposant leur loi et leur « protection » aux commerçants et artisans des quartiers, bandes organisées dont sont membres, parfois dramatiquement rivaux, des parents et autres proches des quatre amies, « On sait tous que notre vie et tout ce pays sont un vaste mensonge ». « Tu sais parfaitement que n’importe quel idiot peut entrer à l’université et s’acheter une place ou même carrément un diplôme ».
Qui a lu le roman de Temur Babluani, Le Soleil, la lune et les champs de blé, publié au Cherche-Midi en janvier 2024, recensé dans le magazine de La Cause Littéraire en mars 2024, notera les similitudes narratives entre ce texte lui-même captivant, dont les intrigues se déroulent également à Tbilissi, et celui, poignant, qui est présenté ici.
Patryck Froissart
Nino Haratischwili est une auteure géorgienne-allemande, née en 1983 en Géorgie. Elle grandit dans un environnement où la culture et la littérature occupent une place centrale. Professionnellement, Nino Haratischwili se lance d’abord dans le théâtre, où elle écrit et met en scène plusieurs pièces qui rencontrent un succès notable. Elle se tourne ensuite vers l’écriture de romans, où elle trouve une nouvelle manière d’exprimer sa créativité et de toucher un public plus large. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve La Huitième Vie (pour Brilka) (2014), un roman épique qui retrace l’histoire d’une famille géorgienne sur plusieurs générations. D’autres œuvres notables dont Mon doux jumeau (2013), et Le Chat, le Général et la Corneille (2021), explorent des thèmes universels tels que l’amour, la perte et la quête d’identité. En plus de ses succès littéraires, elle est une voix influente dans les débats culturels et sociaux, utilisant sa plateforme pour aborder des questions importantes et défendre les droits de l’homme. Son engagement envers la justice sociale et son dévouement à l’art font d’elle une figure respectée.
- Vu : 2907
15:47 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
14/01/2025
L'oeuvre de Dieu, la part du Diable - John Irving
| Titre critique | Le commentaire de Patryck Froissart |
| Étoiles |  |
| Date | 2010-12-12 @ 15:07:19 |
Critique:
Auteur: John Irving
Titre: L'oeuvre de Dieu, la part du Diable
Titre original: The cider house rules
Traduit de l'américain par Françoise et Guy Casaril
Editeur: Le Seuil (1986)
ISBN: 2-02-025780-7
733 pages
Le Dr Larch dirige un étrange établissement, dont la mission unique, la délivrance des femmes enceintes, recouvre deux réalités différentes.
En effet, le Dr Larch est à la fois un accoucheur et un avorteur.
Mais, dans les deux cas, les femmes qui arrivent dans son hôpital repartent sans progéniture. L'embryon retourne à la poussière, et le nouveau-né est immédiatement admis à l'orphelinat, qui fait partie des bâtiments, où il attend sa future famille adoptive.
L'oeuvre de Dieu, la part du diable: pour le Dr Larch, les deux vont de pair, et représentent, autant l'une que l'autre, des actes d'assistance à personnes en détresse.
Les avortements, étant illégaux, sont clandestins.
Le Dr Larch est aidé par deux fidèles infirmières qui lui sont totalement dévouées, à vie.
Toute cette activité s'installe vite dans une routine ponctuée de rites, jusqu'à ce qu'un des orphelins, Homer, se trouve tellement bien dans la compagnie du docteur et des deux nurses qu'il refuse, successivement, toutes les familles qui proposent de l'accueillir et de l'adopter.
Le roman nous conte, en alternance, la longue vie du Dr Larch à l'hôpital et celle, à l'orphelinat d'abord (où Homer finit par devenir l'assistant de celui qu'il considère comme son père) et dans une plantation de pommes ensuite (où Homer rejoint, vers ses vingt-cinq ans, un couple de son âge, Candy et Wally, dont il va partager la vie, le travail, et l'amour).
L'intrigue passionne, les personnages très marqués foisonnent, la liaison occulte de Candy et Homer d'une part, les sentiments qu'éprouvent l'un pour l'autre le Dr Larch et Homer d'autre part constituant le fil conducteur d'un roman à la fois décalé et réaliste.
Ce livre est de ceux dont on regrette toujours d'arriver à la dernière ligne...
Patryck Froissart, St Paul, le 12 décembre 2010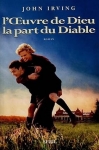
10:28 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
30/11/2024
La femme minérale, chronique de Patryck Froissart
La femme minérale, Nathalie Bénézet (par Patryck Froissart)
La femme minérale, Nathalie Bénézet, Editions Maurice Nadeau, Les Lettres Nouvelles, mai 2024, 110 pages, 17 €

De retour, en Provence, d’un séjour professionnel de plusieurs années en Asie, le personnage principal de ce court roman, une femme alors désœuvrée, tombe par le plus aléatoire des hasards, dans la rubrique hétéroclite des faits divers, sur un article d’un quotidien local relatif au retrait, par décision judiciaire, à un couple totalement démuni de ressources, de ses deux enfants au motif allégué de maltraitance.
Les autorités ayant investi le taudis dans lequel la famille vivait en totale réclusion, tous volets clos, sans contact avec l’environnement social, y auraient découvert les jumeaux déscolarisés, désocialisés, dénutris, en manque de soins.
« Pendant des jours, j’ai pensé à ces gens. […] J’ai pensé à eux comme s’ils étaient des proches. Et je les imaginais seuls, sans les petits, sans plus le droit de ni les n’approcher ni de les voir, jamais ».
Irrésistiblement prise d’une étrange sidération par cette affaire, la narratrice se mettant immédiatement à la recherche du couple avec qui elle désire, sans savoir elle-même pourquoi, entrer en relation, fait la connaissance de Samuel, l’avocat de la famille, avec qui, au fil de sa quête, elle noue une liaison amoureuse.
On découvrira, adroitement esquissées, imbriquées dans la trame romanesque, des bribes de l’histoire personnelle de la narratrice, son bout de chemin avec Patrick, un homme abandonné à sa naissance, un accident ayant décimé sa famille à l’exception du père ; on devine dans ces éléments narratifs le manque, un vide à combler qui pourrait jeter quelque éclairage sur cette étrange démarche dans laquelle elle s’engage à fond malgré les messages sarcastiques que lui envoie sa conscience, ici formalisée sous l’apparence d’une couleuvre virtuelle.
Moyennant une enquête difficile mais opiniâtre, la narratrice retrouve le couple, et, après maintes tentatives d’approche infructueuses, réussit à gagner sa confiance, bien que Joël, taiseux, et Constance, totalement mutique, fermée, impénétrable, éteinte, inerte, statufiée, « femme minérale », restent murés dans une tour de souffrance dont l’auteure a le pouvoir de nous faire ressentir le caractère poignant, lancinant, et irrémédiable.
Constance et Joël sont alors en attente de la révision du jugement, contre quoi ils ont déposé un recours en appel, qui les a privés de leurs droits parentaux. Récusant le terme de « maltraitance », ils en demandent la suppression afin que les jumeaux, parvenus à l’âge de vouloir savoir pourquoi ils leur ont été enlevés, ne se méprennent pas sur les causes du placement.
Et voilà que, face au juge, au procureur, à un public hostile et méprisant, soudainement, la statue s’anime, se dresse, se fait femme, devient mère, se livre, se délivre, ose défier, dans sa douleur qui explose, le tribunal, la salle, la société !
« Mon mari et moi, on les a aimés, les jumeaux, et on les aimera toujours »
[…]
Constance, avec un air de défi :
« Maltraitance, ça dit pas la vérité ».
Le procureur, sans que le président lui ait accordé la parole :
« Quelle vérité ? »
Constance :
« C’est pas parce qu’on aime un enfant qu’on sait forcément comment il faut faire pour l’élever. Ça s’apprend. Nous, on n’a pas appris ».
La vérité, bonnes gens, la voilà, toute nue, toute crue, la réalité sur laquelle l’auteure met le doigt et appuie fort, et ça fait mal au lecteur : la chute, lente mais continue, dans l’enfer de la misère dont on n’a plus l’espoir de sortir, le non-accompagnement, l’isolement, le cloisonnement, volontaire, par peur, par honte, de la cellule familiale, l’indifférence et l’incompréhension du voisinage, la résignation, le renoncement, l’ensemble constituant une sorte de suicide social ayant pour aboutissement une terrible sanction, la stricte et glaciale application d’une mesure de justice administrative méthodiquement dépourvue d’humanité.
C’est le message qu’envoie ce texte.
Après le verdict en appel, les protagonistes se séparent. Constance et Joël retournent dans le monde du silence, dans l’anonymat, dans l’inexistence de fait. Quant à la narratrice, cette tranche de vie douloureuse, quasiment initiatique, provoque en elle le besoin soudain de revoir un père avec qui elle avait rompu quelque temps après le dramatique épisode ayant décimé la parentèle.
« Tant d’années sans se voir. Et à présent, cette envie pressante de le sentir, là, physiquement, une envie de petite fille, impérieuse, presque vitale ».
Une lecture psychanalytique du texte devrait permettre de dégager le rapport entre l’histoire vécue par la narratrice avec Constance et Joël et son désir consécutif de se recréer une famille.
Patryck Froissart
Nathalie Bénézet, née en 1965, a beaucoup voyagé à l’étranger comme chargée de mission de l’Association ATD Quart Monde dont elle dirige aujourd’hui le Centre de Mémoire et de Recherche Joseph Wresinski. Elle a publié Les Moissons de l’absence (2016) et Mon pays c’est le chemin (2018) aux éditions Chèvre-Feuille étoilée. La femme minérale est son troisième roman.
- Vu : 646
13:07 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
26/09/2024
La fille verticale, Félicia Viti (par Patryck Froissart)
La fille verticale, Félicia Viti (par Patryck Froissart)
La fille verticale, Félicia Viti, Gallimard, Coll. Blanche, août 2024, 112 pages, 15,50 €
Edition: Gallimard

C’est l’histoire d’une passion amoureuse entre deux femmes, la narratrice et L. (Elle, tout simplement).
A priori, une intrigue en cours de banalisation dans la littérature contemporaine.
Ce roman court de Félicia Viti sort du lot. La relation entre les deux femmes est houleuse, faite d’une succession de querelles souvent triviales, de vraies et feintes ruptures, de réconciliations sensuellement torrides. L. disparaît, rejoint la faune nébuleuse des noctambules, fêtards, soûlards et drogués des quartiers interlopes de Paris, reparaît abruptement, s’impose, rompt à nouveau, fuyante, inconstante, ne supportant pas l’idée même de stabilité, de confort, ne tenant pas en place, sans cesse en mouvement, ce qui lui vaut cette appellation de « fille verticale ».
« C’est quoi une fille verticale ? C’est la fille contraire à la fille horizontale. A celle qui se couche et qui donne son corps et qui dit je t’aime. La fille verticale c’est celle qui vous tourne le dos quand elle met ses chaussures et qui vous regarde comme un étranger quand elle se réveille. Qui refuse de dîner avec vous, qui s’enfuit quand vous la poursuivrez, qui veut que vous la poursuiviez pour rester debout. La fille verticale c’est une fille qui s’envole dans l’air… ».
Le récit, formé d’un écheveau de courtes scènes, de brèves péripéties, d’états d’âme relatifs à des bouffées émotionnelles circonstancielles, ponctuelles, d’épisodes dramatiques, de souvenirs de jeunesse plus ou moins éclairants, accroche, bien que ces éléments constitutifs soient souvent, apparemment, en disjonction les uns par rapport aux autres, et retient autant que la construction narrative d’un roman linéaire courant. Point n’est besoin pour le lecteur de renouer des fils dont il connaît le dénouement dès le début du récit. La force originale de l’auteure consiste en le développement rapide d’une atmosphère impressionniste que la brièveté assumée des tableaux brossés eux-mêmes de courtes phrases, de touches rapides, de visions et de sensations se succédant comme autant de coups de pinceaux et de coups de couteaux (de poignards, de scalpels ?) contribue d’autant plus à installer et à entretenir qu’elle est littérairement soutenue par un art poétique d’une efficacité impressive remarquable. Il est à noter que par contraste avec l’essence poétique de l’écriture, les fragments narratifs sont contextualisés dans une contemporanéité réaliste, dont on retiendra en particulier la période du confinement consécutif à la pandémie de Covid-19…
L’écriture, qui n’est pas, par certains passages très crus, sans rappeler celle d’une des pionnières du genre romanesque des amours saphiques tragiques, Violette Leduc (Ravages), est en effet à forte dominante poétique, particulièrement lorsqu’elle respire la nostalgie, le regret, la souffrance, la colère, le désastre, le reproche, ou toute autre atteinte d’intense exaltation, jusqu’au paradoxal et antiphrastique aveu, de la part de l’auteure, de l’impossibilité d’exprimer, de traduire, de communiquer l’intime, d’être comprise.
« L’amour c’est un adieu qui insiste. Une plaie d’or dans le thorax. Je ne ferai pas l’effort de vous donner les clés de ce qu’a été le mien. Il n’y en a pas. Les serrures resteront fermées. Une pépite d’or sur la clé d’un tombeau. Vous n’y entrerez pas. Comme moi vous chercherez à l’attraper. Le saisir. Le tordre.
Et sans succès, il vous faudra juste vous atteler à suivre la même chose que moi.
Elle ».
Patryck Froissart
Félicia Viti est une romancière française, scénariste et réalisatrice pour la télévision. Elle a notamment co-écrit et co-réalisé la série Back to Corsica pour France-TV.
- Vu : 320
09:17 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Aux ventres des femmes, Huriya (par Patryck Froissart)
Aux ventres des femmes, Huriya (par Patryck Froissart)
Aux ventres des femmes, Huriya, Editions Rue de l’Echiquier, août 2024, 320 pages, 22 €

Après Entre les jambes, publié en avril 2021, un premier roman contestataire, provocateur, qui lui a apporté une immédiate notoriété, Huriya, écrivaine franco-marocaine, récidive avec ce récit tout autant percutant des quinze premières années de l’existence quotidienne de la fille cadette d’un boucher polygame et tyrannique tirant des préceptes de l’intégrisme islamique la légitimité de son odieux comportement domestique.
L’histoire se déroule dans un état islamique non identifié, dans le quotidien de quoi on peut reconnaître ici et là des éléments socio-culturels, socio-religieux, socio-linguistiques propres à telle ou telle communauté régionale du monde arabo-musulman.
Shahrazade, narratrice et héroïne du roman, dernière-née d’une cohorte de huit filles à qui la troisième épouse du boucher n’a pu, de même que les deux premières, à la grande fureur dudit mari, donner un héritier mâle, Shahrazade, rejetée, méprisée par son père qui la tient pour un être inachevé puisque non pourvu des attributs masculins qui font la fierté et l’honneur d’un respectable chef de famille, dénonce, en mettant en lumière les détails les plus intimes, les plus triviaux, les plus scabreux, voire les plus sordides des relations interfamiliales, l’hypocrisie d’une morale religieuse de façade, l’emprise infernale d’un système patriarcal conforme à de prétendus commandements divins n’accordant à la femme qu’un devoir absolu d’obéissance aux décisions de l’homme, aussi arbitraires, cruelles, iniques soient-elles, avec, pour corollaire, l’obligation de se plier à ses moindres désirs, à ses caprices, à ses vices, à ses sévices, sans un battement de cil de rébellion.
« Tu dois obéir !
Pourquoi ?
Parce que tu es une femme !
[…]
Dès leur plus jeune âge, on façonne les filles pour que leur esprit soit docile. Nées punies, on leur enseigne à accepter leur condition et on les dresse à obéir. Une femme se soumet, point ! Voilà ce que les lois froides de nos contrées ont fait de nous ».
Dans cette société cloisonnée faite d’une juxtaposition de dictatures domestiques exercées sur la femme, Shahrazade, possible lointaine et subtile réincarnation de celle qui sut vaincre à sa manière le despotisme délirant de Schahriar, Shahrazade, dès qu’elle est en âge de comprendre l’absurde iniquité de la condition de ses mère, tantes et sœurs, ose questionner, demander raison, protester malgré la certitude d’en être immédiatement et impitoyablement châtiée par le tyran.
Jusqu’à l’extrême point de rupture.
« Un jour je sortirai de l’arbre généalogique. Je ne suis pas née dans la bonne famille. Ma place n’est pas ici ».
Roman fort bien écrit, objectivement fondé sur des situations sociales bien réelles, construit sur une succession de péripéties poignantes s’inscrivant dans l’atmosphère ténébreuse d’une cellule microcosmique dont les éléments interagissent de façon socialement occulte entre quatre murs dans une tension croissante, ce deuxième ouvrage de Huriya est à rapprocher de celui de l’écrivaine française d’origine marocaine Kaoutar Harchi, A l’origine, notre père obscur (Actes Sud 2016) et de celui de R. K. Narayan, Dans la chambre obscure (Zulma 2014), dont le dessein est semblablement de lever le voile sur les effets tragiques, insupportables, des intégrismes religieux, sur l’aberration ignominieuse des hommes qui en appliquent les principes, ces êtres inhumains dont une des protagonistes âgées du présent récit se demande avec désespoir d’où a surgi l’engeance.
« Et dire que je les ai connus à la mamelle et que j’ai bercé sur mes genoux des enfants devenus des diables ! Mais comment ont-ils sombré dans l’horreur ?
[…] Ces hommes ont prêté serment d’allégeance au Diable.
– Où est Dieu ?
– Dieu s’est enfui ! »
Patryck Froissart
Huriya est née et a grandi à Marrakech. A dix-sept ans, elle quitte le Maroc pour la France, où elle entreprend des études de philosophie. Elle est l’auteure d’une dizaine de romans sur la pauvreté, la banlieue et les migrations, publiés sous pseudonyme. Elle a aujourd’hui deux passeports, deux identités, et deux pays, puisqu’elle partage son temps entre le Maroc et la France.
09:16 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Ténèbres, Thomas Bernhard (par Patryck Froissart)
Ténèbres, Thomas Bernhard (par Patryck Froissart)
Ténèbres, Thomas Bernhard, Maurice Nadeau Poche, juin 2024, trad. Claude Porcell, Jean De Meur, 131 pages, 9,90 €
Ecrivain(s): Thomas Bernhard Edition: Editions Maurice Nadeau

La Maison Maurice Nadeau réédite en sa Collection Poche cette compilation de discours et d’entretiens de Thomas Bernhard publiée initialement chez le même éditeur le premier octobre 1986. L’ensemble réunit cinq discours, une auto-interview, un long entretien avec le journaliste autrichien André Müller (1946-2011) et une Chronologie réalisée par Claude Porcell.
* Le Froid augmente la clarté (1965)
Dans cette allocution prononcée à l’occasion de la remise du Prix de Littérature de la Ville Libre de Brême, Bernhard oppose l’univers enchanté des Musiciens de Brême, ce conte local rendu célèbre par les frères Grimm, à ce qu’est devenue, selon lui, l’Europe qui « il y a cinquante ans encore […] était un vrai conte de fée » :
« L’Europe, la plus belle, est morte ».
* A la recherche de la vérité et de la mort (1967 et 1968)
Deux discours.
Prononcé lors de la remise du Prix National autrichien de littérature en 1967, le premier, censé être un message de remerciements pour l’attribution de cette haute distinction patriotique, constitue de fait, suprême provocation ! extrême inconvenance ! une virulente diatribe contre « la décadence » de l’Etat et du peuple autrichiens, et provoque incidemment, lors de sa déclamation, une réaction hostile du Ministre de l’Education et d’une partie de l’assistance.
L’incident entraînera l’annulation de la cérémonie de remise d’une autre récompense, celle du Prix Wildgans de l’Industrie autrichienne, et conséquemment l’interdiction de l’énonciation publique du discours préparé par Bernhard pour cette circonstance, dont tout le texte, reproduit ici sur une douzaine de pages, est l’exemple absolu de paralipse à effet caustique dressant sarcastiquement le funeste tableau d’une société gangrenée, sinistrement crépusculaire, ce qui eût probablement valu à son auteur, s’il eût eu la liberté d’en faire une lecture publique, de la part de l’auditoire, des manifestations, pour ou contre, d’une violence bien plus éruptive que celles provoquées par le premier discours.
* L’immortalité est impossible – Paysage d’enfance (1968)
En réponse à la demande de la Revue Neues Forum, adressée à divers auteurs autrichiens, d’écrire un texte sur les paysages de leur enfance, Bernhard se lance dans une description férocement contemptrice du microcosme dans lequel s’est déroulée son enfance, de la nature des relations entre tous les protagonistes de toutes conditions, de toutes professions, de tous statuts qu’il a rencontrés, de leurs interrelations et interactions sociales portant toutes, selon lui, la marque unique, quasiment congénitale, du « mépris » d’autrui.
Seules figures positives émergeant de cette tranche de vie primordiale : les grands-parents de l’écrivain, chez qui il a passé une partie de son enfance, et en particulier son grand-père, « un philosophe qui me découvre, qui m’éclaire ».
* N’en finir jamais ni de rien (1970)
Ce court discours prononcé lors de la remise du Prix Büchner en 1970 est l’expression d’un désabusement profond, total, définitif, d’un dégoût irrémédiable que déverse Bernhard sur son propre travail d’écrivain, sur l’inhérente hypocrisie des mots, sur les sens (l’essence) de plus en plus insaisissables de ces mots qui se dissolvent « dans le malentendu fatal et finalement létal de la nature où nous perd aujourd’hui la science ».
* Trois jours (1970)
Cette « auto-interview » qui s’est déroulée en 1970 sur un banc de la banlieue de Hambourg, long monologue face à une caméra, comprend trois parties. Bien qu’une thématique semble se dégager de chacun des trois textes, le locuteur s’y laisse aller volontiers à divaguer.
Dans « Le premier jour », Bernhard évoque encore son enfance, sous la forme de bribes, d’impressions : sur le chemin de l’école, la vision quotidienne de l’étal sanglant du boucher, le cimetière, les visites régulières, morbides, à la morgue avec la grand-mère, la rencontre fréquente d’une femme lui criant qu’elle finira bien « par envoyer son grand-père à Dachau » ; la mise en nourrice ; des diversions sur l’incommunicabilité, sur les suicides de nombre de ses ascendants.
« Se faire comprendre n’existe pas, est impossible »
« Le deuxième jour » commence par une réflexion sur la difficulté d’être, sur la pénibilité de faire, sur la puissance de la résistance quotidienne à cette double pesante obligation d’être et de faire, et se poursuit par une analyse par l’auteur de son activité d’écrivain, avec un essai de réponse à la question qui s’impose aux lecteurs de ses œuvres :
« Pourquoi cette obscurité, toujours cette obscurité totale dans mes écrits ? ».
Dans « Le troisième jour » le discours se fait d’abord plus précisément métalittéraire et intertextuel, l’écrivain se référant à ses lectures, aux auteurs qui ont déterminé, par comparaison ou, bien davantage, par antinomie, son propre art littéraire. Après quoi Bernhard révèle son penchant pour l’état de « mélancolie », son étrange attrait pour les cimetières, la « conversation avec son frère qui n’a pas eu lieu, [la] conversation avec sa mère qui n’a pas eu lieu ».
* Entretien avec André Müller (1979)
Cette partie, la plus longue du corpus, reproduit un dialogue vif, souvent amusant, un tac au tac soutenu, une suite de réparties parfois incisives, voire caustiques, au cours de quoi le journaliste interpelle (courtoisement) Bernhard sur son mode de vie, sa quasi réclusion, la nature et l’histoire de son lien affectif avec « sa tante » (présente et participant à l’échange au début de la conversation), sa relation avec le monde littéraire, ses tendances suicidaires, et cetera. Bernhard s’y montre tantôt spontanément ouvert, tantôt fuyant, détournant ou ignorant la question, tantôt un brin cabotin, tantôt cynique, parfois émouvant, ce qui confère à ce face-à-face une captivante théâtralité.
En guise de conclusion : ce recueil de libres confessions, d’évocations décousues du passé, de dévoilements, d’indiscrétions volontaires, d’aveux, de confidences sur le divan projette un éclairage intéressant sur la sombreur essentielle des écrits de Bernhard, sur le pessimisme existentiel empreignant la vision qu’il a de sa présence au monde, sur l’appréciation négative qu’il fait de sa propre création littéraire, sur le regard critique, substantiellement péjoratif, qu’il porte itérativement sur l’espèce, sur la société, sur l’Histoire, en particulier contemporaine.
* Chronologie (Claude Porcell)
L’ouvrage s’achève sur cette chronologie détaillée de la vie et de l’œuvre de Bernhard, dont les éléments choisis complètent la possibilité (que rejette paradoxalement, explicitement, l’écrivain) d’une interprétation psychanalytique de son écriture par le prisme de sa biographie.
Patryck Froissart
Thomas Bernhard, écrivain et dramaturge autrichien (1931-1989). Une enfance à Salzbourg auprès de son grand-père maternel, au temps du nazisme triomphant, marque le début de l’enfer pour Thomas Bernhard. Suite à l’Anschluss en mars 1938, il est envoyé dans un centre d’éducation national-socialiste en Allemagne puis placé dans un internat à Salzbourg où il vivra la fin de la guerre. Atteint de tuberculose, Thomas Bernhard est soigné en sanatorium, expérience qu’il inscrira dans sa production littéraire. Il voyage à travers l’Europe, surtout en Italie et en Yougoslavie puis revient étudier à l’Académie de musique et d’art dramatique de Vienne ainsi qu’au Mozarteum de Salzbourg. Son premier roman, Gel, lui vaut l’obtention de nombreux prix et une reconnaissance internationale. Par la suite, Thomas Bernhard se consacre également à des œuvres théâtrales. En 1970, Une fête pour Boris remporte un grand succès au Théâtre allemand de Hambourg. Paraît ensuite, entre 1975 et 1982, un cycle de 5 œuvres autobiographiques : L’Origine ; La Cave ; Le Souffle ; Le Froid ; Un enfant. En 1985, Le Faiseur de théâtre, véritable machine à injures, fera scandale. Mais c’est avec Heldenplatz, son ultime pièce, que Thomas Bernhard s’attirera le plus d’ennuis, dénonçant une fois encore les vieux démons de son pays : l’hypocrisie et le fanatisme d’une société toujours aux prises avec le national-socialisme. Thomas Bernhard meurt trois mois après la première. Dans son testament, il interdira toute représentation de ses pièces de théâtre dans son pays natal.
09:13 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
15/05/2024
Mots décroisés, Patrick Devaux (par Patryck Froissart)
Mots décroisés, Patrick Devaux (par Patryck Froissart)
Mots décroisés, Patrick Devaux, Editions du Cygne, octobre 2023, 45 pages, 10 €
Edition: Editions du Cygne

Préfacé par la poétesse Parme Ceriset, ce nouveau recueil de Patrick Devaux, faisant référence inversée aux grilles des cruciverbistes, est un montage délicat de « poèmes verticaux » dont quasiment tous les « vers » sont constitués systématiquement d’un mot unique ou, plus rarement, de deux.
Personnages : une femme, simplement désignée par un pronom, « elle », en train de croiser et décroiser les mots « comme on croise et décroise les jambes », et le poète narrateur qui la tient dans l’empan de son regard attentif, qui imagine, traduit et exprime ce qu’elle fait, ce qu’elle pense, ce qui l’occupe et la préoccupe, le poète voyeur à qui, incidemment, elle demande de « l’aider à trouver », ce qui pose ces questions immédiates :
que cherche-t-elle ?
quel sens veut-elle donner à quoi ?
La juxtaposition, dans le cadre fermé des grilles des cruciverbistes, de cases blanches et de cases noires, évoque évidemment le pavé mosaïque, dont les interprétations symboliques les plus courantes reposent sur l’inévitable dualité dans l’existence d’éléments positifs et négatifs, d’événements heureux et malheureux, dans la traversée de quoi doivent être recherchés sans cesse un équilibre naturellement précaire et une stabilité toujours menacée, mais aussi sur la constante opposition entre le Bien et le Mal, ou sur complémentarité existentielle de la Vie et de la Mort.
Sous-jacent, omniprésent, apparaît entre les lignes, entre les cases, le thème de la communication, de sa modération, de ses difficultés, de ses limites, de la recherche constante et nécessaire « du mot juste » dont « la quête peut s’avérer fructueuse » sous la forme de « petits pas l’un vers l’autre » le mot qui pourrait « réactiver les temps morts entre échange horizontal ou vertical », mais dont l’action se heurte inévitablement aux sens potentiellement obscurs du lexème, à celles de ses significations qui échappent à l’appréhension, qui s’éloignent à mesure qu’on croit les saisir :
« mot mystère
comme
on plonge
un doigt
très pauvre
dans
une galaxie lointaine »
Et il y a l’omniprésence du non-exprimable, du non-communicable, représentée par « les petites cases non dites »…
En référence aux cases noires de la grille sont évoqués les « trous noirs » que sont les trous de mémoire, les mots qui sont sur le bout de la langue et qui n’émergent pas, mais aussi le « mot manquant », douloureusement inexistant dans le vaste champ lexical, celui sans quoi l’expression est défaillante, inexacte, imprécise, celui qui développe la « solitude » du poète (figure récurrente dans le recueil) devant la page blanche, mais encore « les mots tremblants cherchant l’issue », possiblement interdits, la case blanche rappelant alors ce « carré blanc » qui instaurait jadis au bas de l’écran des téléviseurs une censure liée à l’âge des spectateurs. Est encore invoqué « le mot perdu » à quoi réfèrent certains rites initiatiques à propos de la légende de la mort d’Hiram. L’alternance de cases noires et blanches rappelle par ailleurs au poète le clavier d’un piano qui serait, déplorablement, privé du « moindre son ». Dans le même champ, surgissent de symboliques acouphènes qui déforment les mots, qui les projettent dans un « temps disjoncté » où ils deviennent insaisissables.
La grille, c’est la prison, bien évidemment, cette prison dans laquelle le mot est enfermé, d’où il ne peut sortir, cette gangue de traits sémantiques qui lui sont imposés par le dictionnaire, ce costume contraignant, empesé, conventionnel dont seul le poète « en attente de solution » a le pouvoir de le libérer.
Verticalité, horizontalité… Sans qu’il ait besoin de recourir aux théories d’analyses linguistiques bidimensionnelles (paradigmatique / syntagmatique), voire tridimensionnelles (paradigmatique / syntaxique / sémiotique), le lecteur ne pourra manquer de remarquer que la verticalité formelle, lexicale, des poèmes du recueil confère à chaque mot un espace d’interprétations dont l’ampleur ne cesse de croître à chaque relecture.
Patryck Froissart
Né à Mouscron le 14 juillet 1953, Patrick Devaux éprouve dès l’enfance une attirance très forte pour la poésie. Poète discret pour ne pas dire timide, et volontiers enclin à la modestie, Patrick Devaux aborde progressivement dans ses thèmes tous les sujets de vie et de mort, d’ombre et de lumière. Son écriture, d’une lapidaire précision, l’impose rapidement comme une des valeurs sûres de la poésie contemporaine. Reconnu en Belgique, il ne tarde pas à l’être dans les autres pays de la francophonie, notamment en France, où il est publié par diverses revues, dont « Les saisons du Poème », l’une des premières à lui ouvrir ses pages. Il partage son temps libre entre l’écriture, la peinture et les voyages.
- Vu : 108
17:59 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
Quemhrf ! (en manège), Christoph Bruneel (par Patryck Froissart)
Quemhrf ! (en manège), Christoph Bruneel (par Patryck Froissart)
Quemhrf ! (en manège), Christoph Bruneel, Editions de l’Âne qui butine, Coll. Xylophage, décembre 2023, 290 pages, 22 €

Que voilà un remarquable OLNI dans le voyage vertigineux de quoi tout lecteur et toute lectrice ne peuvent éviter de se laisser jubilatoirement emporter, noyer, dès l’embarquement ! Objet Littéraire Non Identifiable, cette nouvelle publication de l’Âne qui butine vaut d’abord par le raffinement de son apparence extérieure, la qualité de son papier, l’esthétisme de ses illustrations (les photographies sont l’œuvre de l’auteur).
Bateau ivre que le naute lance sans boussole apparente, comme à l’errance, dans l’océan tantôt démonté, tantôt trompeusement uniforme, de son imagination débridée, vers des destinations a priori inconnues, aux limites improbables, le texte mêle récit hallucinant, péripéties désorientées soufflées par quelque muse défoncée et ponctuellement lyrique et lubrique, morceaux de pure poésie, et, ici et là, des sommes de pages inattendues que l’auteur présente comme des interludes.
Les épisodes narratifs ont pour personnage principal un certain Quemhrf, qui actionne et mène le manège désaxé (en tous les sens du terme) d’acolytes burlesques affublés respectivement des noms suivants, parfois comiquement déformés en cours d’action : Bouchère, Bûcheron, les sœurs Asymptotes, Planche Piège et ses sept Puces, Nonnette, Le Nouveau Client, Tranche-Braise et ses sept Nabots, Balthazar de la Bamboche, la Belle Encuisse, et autres acteurs de baroque vêture.
Qui donc est Quemhrf ?
« Quemhrf ! ingénu venu d’un zeugme zonier sans suite ni reconduite, car à l’air carillonné libre, ivre de livres caractériels et carabistouillés […] aux palimpsestes pataphysiques en poupe […].
Quemhrf ! l’homme qui avait toujours raison, même dans l’assiette de l’autre ».
Tout est dit, n’est-il pas ?
L’entrée en matière annonce sans préambule, sans préavis, de façon tonitruante, le délire lexico-sémantique qui va suivre :
« Voici venir de la fente tirelire la chère bien-aimée Bouchère & l’adulé chérot Bûcheron, qui, de brio, au gallodrome de leurs amants ébats, se bouchonnent, se bichonnent, se briochonnent le glas sous un faux air de Brabançonne ».
Suivent, fusent, exagèrent, s’exaspèrent, se bousculent, se télescopent, déraillent, fourchent, explosent en gerbes d’inventivité des épisodes narratifs fluant, coulant, dérivant dans le cours d’une écriture caractérisée par une succession d’associations lexicales fondées sur une proximité tantôt sémantique, tantôt graphique, tantôt phonique, et par des envolées, diversions, énumérations farcesques à la truculence d’un Rabelais que l’auteur, à maintes reprises, affirme être son principal référent littéraire.
Tout va dans tous les sens et, magie de la langue, du non-sens apparent naît un sens probable, ou plutôt naît un nuage de sens possibles. Et surgissent, inopinément, ces étranges interludes, dont on peut retenir, entre autres fantaisies au demeurant à la fois intéressantes et amusantes : un dialogue documenté entre S. Van Rompaey et R. Vermaut à propos d’une « fontaine des Trois Pucelles » à Bruxelles, un article sur l’alfa extrait d’un « Glossaire du Papetier », une recette pour fabriquer soi-même sa pâte à raser, un texte poético-théâtral sur Jeanne Hachette, une furieuse divagation de style papal intitulée « Urbiette et Orbiette », plusieurs tomes longs et denses, partagés par tranches thématiques (faune terrestre, faune marine, flore, toponymie…), dans l’ouvrage, du « répertoire dictionnaire glossaire lexique d’un anonyme » aux articles agrémentés de commentaires loufoques, une lettre de Mme de Sévigné à sa fille, une présentation détaillée de Désiré Tricot, « poète prolétaire oublié de justesse », et la reproduction d’un de ses poèmes, un texte de forme classique en décasyllabes en hommage à la Flandre et aux Flamands en réplique à un texte méprisant publié par un certain Ansieaux, un pamphlet puissant sur « les mots » ayant pour titre « Wordsbomb » et pouvant traduire le manifeste littéraire de l’auteur :
« son ou réunion de sons
[…]
muttum - verbum - lexis - mot
agrafez-les
dégriffez décriez dépliez
massicotez congelez étirez
réduisez-les en compote
malaxez broyez évaporez
les mots ! rien que les mots !
appropriez-vous les mots ! ».
Il y aurait tant et tant à dire à propos de ce texte fourmillant de trouvailles, d’inventions, de transgressions, de violations linguistiques ! On terminera par ce chant cocasse qui rappelle que Bruneel cultive allégrement son bilinguisme franco-néerlandais, qu’entonnent en chœur, en levant leur verre, tous les personnages en guise d’épilogue :
« Viva Bomma giet ze moar
Patatten en Saucissen binnen !
Nunc viva est Bomma
Patatten en bibendum Sala !
En daarbij
A mon commandement
Een dikke Cervelas ! ».
A votre bonne santé, godverdomme, lecteurs et lectrices !
Patryck Froissart
Christoph Bruneel, né le 21 février 1964 en Belgique, est relieur, restaurateur et concepteur de livres (en 1996 & 1997 : médaille de bronze de la Guilde des relieurs flamands). Se définissant comme un jardinier de langues, et triturateur d’idées, Bruneel est également auteur bilingue français néerlandais. De ce chassé-croisé naît sa littérature érudite, humoristique, truculente.
- Vu : 447
17:58 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
30/03/2024
Ravages, Violette Leduc (par Patryck Froissart
Ravages, Violette Leduc (par Patryck Froissart)
Ravages, Violette Leduc, Gallimard, Coll. L’imaginaire, novembre 2023, 444 pages (édition augmentée), 23 €
Ecrivain(s): Violette Leduc Edition: Gallimard

Cette œuvre monumentale de Violette Leduc n’avait jamais, au grand dam de l’auteure, été éditée dans son intégralité, ayant été, dès sa première parution chez Gallimard en 1955, expurgée, fragmentée, remaniée à la demande expresse de l’éditeur, déplorablement dénaturée, mutilée, amputée d’un coup de couperet de sa première grande partie représentant un bon quart du texte, et tronquée de très nombreux éléments dans ce qui restait de l’ouvrage.
Cette nouvelle édition est donc une revanche, hélas posthume, pour l’auteure, et une action d’utilité publique en matière littéraire.
Le volume physique qui fait écrin à la présente reconstitution, minutieuse, relevant quasiment de la fouille archéologique, du projet primordial, fruit d’un remarquable travail de recherche sur les essais et brouillons primitifs et les constituants élémentaires originaux non publiés (en grande part retrouvés par fragments dans les « Cahiers » d’archives de Simone de Beauvoir à qui Violette Leduc adressait régulièrement ses écrits, ses premiers jets, pour recueillir l’appréciation de celle avec qui elle entretenait une étroite relation d’amitié et de complicité littéraire) offre immédiatement un attrait esthétique indéniable par le choix de la couleur – violette – des couvertures, de celle – violette – des pages intérieures séparant les parties ayant été déjà publiées de celles qui avaient été censurées, de celle – violette – des caractères typographiques caractérisant la réintégration des innombrables parties, épisodes, passages, phrases, fragments, voire mots uniques exclus des précédentes éditions.
Cette édition est recomposée, conformément à la conception originelle, en trois parties qui se tiennent entre elles, qui sont liées, filées, dont le flux narratif est incontestablement continu, dont le personnage principal est Thérèse, narratrice à la première personne, laquelle revit trois périodes à la fois exaltantes et douloureuses de son existence, de l’âge de dix-sept à trente-quatre ans.
Dans la première partie, celle qui a été immédiatement et intégralement censurée pour obscénité, Thérèse met en scène sa liaison torride avec Isabelle, une de ses condisciples d’internat scolaire. La relation passionnelle, volcanique, des deux adolescentes est, à leur grand désespoir, brutalement interrompue, à l’issue de seulement quelques jours et nuits d’amours saphiques clandestines et dévorantes couvrant cent quinze pages, par la décision que prend de manière impromptue la mère de Thérèse de la retirer du pensionnat.
Dans la seconde, Thérèse vit en couple, en province, quelque temps plus tard, avec Cécile, une enseignante, ancienne surveillante en l’internat où s’est déroulée l’épisode initial. Elles reçoivent la visite inopinée de Marc, personnage socialement et professionnellement instable que Thérèse a rencontré au cours d’une de ses propres errances citadines, lors d’une des fugues répétées en réaction au remariage de sa mère. La narratrice entretisse ici sur cent-soixante pages les circonstances et le déroulement de sa première rencontre avec Marc et des rendez-vous qui ont suivi jusqu’à leur rupture avec l’évolution, au quotidien, de sa relation avec Cécile et le récit de l’intrusion surprise de Marc dans leur couple, de son bref séjour dans leur intimité, des conséquences de cette présence qui leur est imposée, et de la disparition, toute aussi subite et en catimini, du visiteur.
Dans la troisième, Thérèse, ayant quitté Cécile, retrouve dans la capitale Marc stabilisé, devenu photographe de mariages, vivant avec sa mère et sa sœur. Ce chapitre de cent-trente pages raconte les aléas de leur union chaotique, tourmentée, en constante tension dramatique.
L’écriture n’a pas sa pareille, incluant une part majeure de dialogues haletants, d’une violence souvent extrême, aux reparties brèves, constamment lourdes de sous-entendus, toujours expressions de désirs, de reproches, de jalousies, d’invites, de rejets, d’accusations, de querelles, de pardons, de sensualité, d’angoisse du devenir, de crainte de rupture, d’excessive possessivité, ou accompagnant et traduisant oralement, crûment, le déroulement des scènes sexuelles.
Entre des échanges incisifs, entre d’ardents badinages, entre des cascades de répliques criées, gémies, murmurées, délirantes, haletées dans l’embrasement des sens, entre ces phases dialogiques saisissant le lecteur au cœur, à l’âme et aux tripes, le récit, où le passage fréquent du passé au présent exprime l’ardeur de l’émotion qui saisit la narratrice se remémorant les situations qu’elle est en train de transcrire, est également d’une véhémente impressivité, tant y dominent sentimentalité, révolte, débridement, mise à nu, liberté de parole et de ton, le tout tantôt éclatant de théâtralité, tantôt vibrant d’emballement, de délire ou de brûlante suggestivité poétique.
« Donnez-nous vos haillons, saisons ! Soyons les vagabondes aux cheveux laqués par la pluie. Veux-tu, Isabelle, veux-tu te mettre en ménage avec moi sur le bord d’un talus ? nous mangerons nos croûtons avec des mâchoires de lion, nous trouverons le poivre dans la bourrasque, nous aurons une maison, des rideaux de dentelle pendant que les roulottes passeront et s’en iront aux frontières. Je te déshabillerai dans les blés, je t’hébergerai à l’intérieur des meules, je te couvrirai dans l’eau sous les basses branches, je te soignerai sur la mousse des forêts, je te prendrai dans la luzerne, je te hisserai sur les chars à foin, ma Carolingienne ».
Ainsi sont puissamment restitués l’exaltation de l’initiation mutuelle au saphisme avec la frénétique Isabelle, le réalisme cru et la brutalité du viol imposé à Thérèse par Marc le soir de leur première rencontre (scène dite « du taxi »), l’éprouvante désagrégation de la relation avec Cécile, le calvaire provoqué par la constatation croissante de l’impossibilité de vivre avec Marc, le suicide raté au gaz, l’amour maternel retrouvé en cette circonstance, les souffrances physiques et psychiques provoquées par les tentatives répétées, acharnées, illégales à cette époque, de mettre fin à une grossesse abhorrée par le recours aux faiseuses d’anges et aux médecins cupides et sans scrupule.
Le caractère pionnier, avant-gardiste, révolutionnaire de cette écriture féminine, féministe, violente, fulgurante, rebelle, contrevenant à toutes les règles sociales et morales de l’ordre bourgeois patriarcal établi, faisant voler en éclats tous les tabous imposés à la femme, à sa sexualité et à l’expression même de celle-ci, proclamant une totale liberté à disposer de soi, de son corps, de son sexe, et, intolérable transgression de la loi naturelle ou prétendument divine imposée au genre féminin, à refuser de procréer, ne pouvait pas, au milieu du siècle dernier, échapper au hachoir et au scalpel des gardiens de l’ordre.
Cette édition ? Un événement, forcément.
Patryck Froissart
Violette Leduc (1907-1972) n’a été révélée au grand public qu’en 1964 avec le succès de La Bâtarde. Mais elle avait publié auparavant des livres qui lui avaient valu l’estime de Jean Genet, Sartre et, surtout, de Simone de Beauvoir.
- Vu : 220
14:09 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|
25/03/2024
Désappartenir, Psychologie de la création littéraire, Sophie Képès (par Patryck Froissart
Désappartenir, Psychologie de la création littéraire, Sophie Képès (par Patryck Froissart)
Désappartenir, Psychologie de la création littéraire, Sophie Képès, Editions Maurice Nadeau, octobre 2023, 234 pages, 19 €
Edition: Editions Maurice Nadeau

Désappartenir.
Psychologie de la création littéraire.
L’association titre et sous-titre, énigmatique a priori, prend rapidement sens à la lecture de cet ouvrage dense que l’autrice qualifie d’essai autobiographique.
Sophie Képès a publié une partie de son œuvre sous le nom de Nila Kazar, ce qu’elle analyse ici avec le recul comme le désir d’effacer son appartenance à une ascendance dont elle a découvert que certains de ses membres, y compris son propre père, ont eux-mêmes occulté le lignage ashkénaze, tout en adoptant paradoxalement ponctuellement un pseudonyme par l’usage duquel elle se rattache volontiers à un arbre généalogique profondément enraciné en Hongrie. L’usage systématique du TU au lieu du JE contribue à ce souci d’effacement de soi.
« Parmi ses omissions majeures, ton père a caché ses origines juives à ses cinq enfants […]. Par la suite tu as découvert que le refus de transmettre est une caractéristique du pervers narcissique. S’attaquer aux liens est sa vocation. Cela inclut les liens de la généalogie ».
Associant cette volonté, parfois inconsciente, d’annihiler ses origines à celle, définitive, actée, consommée de sa rupture relationnelle avec un père, une mère, une sœur aînée qui ont fait de son existence d’enfant non désirée une longue litanie de vexations, d’humiliations et, concernant précisément la mère, de possibles agressions à caractère incestueux, Sophie Képès-Nila Kazar se lance dans une autopsychanalyse de ses écrits romanesques et réalise, s’explique et démontre que sa propre œuvre de création littéraire est expressément marquée, orientée, impressionnée par les stigmates de telles et telles carences affectives et souffrances physiques et morales ayant affecté son enfance.
Cette introspection, alimentée fondamentalement par une rétrospection mémorielle minutieuse, circonstanciée, décortiquée occupe, sous la forme de fragments narratifs, presque à part entière les premiers chapitres de l’essai puis vient récurremment illustrer et étayer, l’autrice comparant ponctuellement son propre « cas » à ceux d’un nombre considérable d’illustres créateurs, écrivains, poètes, peintres, musiciens, la somme monumentale de recherches littéraires érudites qui constitue l’essai proprement dit.
Tout en établissant des relations de causes à effets entre son enfance, certains de ses actes d’adulte, et ses livres, tout en allant de l’avant, concomitamment, dans sa quête intérieure en particulier et dans son enquête sur la création artistique en général, l’autrice constate, et s’en étonne, que les psychobiographes n’attachent pas à la relation entre l’œuvre et l’enfance des créateurs toute l’importance qu’elle mériterait et qui, selon elle, serait de nature à mieux éclairer la genèse et la structure élémentaire de l’œuvre artistique en cours de construction, et de sa composition achevée.
Alors elle opère elle-même cette mise en rapport. Et elle se livre, et nous convoque à une reconstitution narrative méticuleuse des années d’enfance de dizaines des plus grands créateurs dans leur cadre social, familial, généalogique, compare le vécu, la parentèle et les origines des uns et des autres, y intègre les siens, met en évidence d’indéniables coïncidences, et aboutit à un « diagnostic » général des conditions psychiques les plus favorables à la naissance et à l’épanouissement du génie artistique, en particulier littéraire.
Paradoxe apparent, pour désappartenir, il faut d’abord bien savoir à quoi et à qui on appartient… Sophie Képès s’adonne donc en cours d’écriture à une passionnante quête de ses origines paternelles et maternelles.
Ecriture bastion, de repli face à la méchanceté, de carapace contre l’injustice, écriture refuge, écriture évasion vers un ailleurs meilleur, écriture isolement et écriture solitude désirée, écriture vengeance et écriture révolte contre un milieu générateur de souffrance, écriture pour vivre, pour survivre aux séquelles du passé, écriture pour « reprendre le contrôle » de l’existence de soi, écriture tentative de réponse à des interrogations existentielles personnelles, écriture militante, écriture révélation, écriture confession, écriture thérapie, écriture catharsis, écriture dévoilement, écriture exhibition, écriture prémonition, écriture sexualité, mais dans la même texture, inextricablement, inexorablement, écriture héritage, toutes ces expressions scripturales devraient communément leur surgissement artistique à des enfances difficiles avec lesquelles il est vital de prendre de la distance, marquées par le manque ou la souffrance, par l’absence du père, de la mère, des deux parents, par l’abandon, le rejet, par des deuils répétés, la maladie, par le mépris, les moqueries, les sévices, l’inceste, et cetera.
En témoignent, confrontées aux dits et aux écrits (romans, poèmes, réflexions, essais, interviews, lettres) des auteurs, de leurs correspondants, de leur entourage, les enfances de Kafka, de Stendhal, de Balzac, de Sand, de Hugo, de Nerval, de Virginia Woolf, d’Anaïs Nin, de Romain Gary, de Nancy Huston, de Danilo Kiš, de Cyrulnik, de Constant, de Maupassant… Sophie Képès et Nila Kazar, entre autres, la liste complète ici ne pouvant tenir place. Quelle érudition ! Quelle capacité à embrasser et à brasser une telle amplitude du champ littéraire !
Sophie Képès réussit à éprouver par cette thèse remarquablement élaborée le postulat exprimé par le titre, cette aspiration à désappartenir à un passé, à une histoire personnelle, peut-être pour réappartenir au présent et au futur, ce besoin plus ou moins conscient de se recréer que peuvent révéler dans l’œuvre, y compris dans l’écrit autobiographique, les omissions, les négations, les mensonges, les dénonciations, les vrais ou faux aveux, la refondation, plus globalement le remplacement du « vrai » vécu par un vécu réécrit.
Patryck Froissart
Née à Paris, Sophie Képès écrit sous son nom et sous le pseudonyme de Nila Kazar. Lauréate de plusieurs résidences nationales et internationales, elle a publié romans, nouvelles, documents, articles, traductions du hongrois, et elle collabore à des films de fiction et des documentaires. Elle enseigne la création littéraire et le scénario à l’université.
- Vu : 1579
15:39 Écrit par Patryck Froissart dans Les chroniques de Froissart | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  Imprimer |
Imprimer |  |
|







